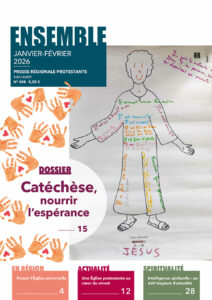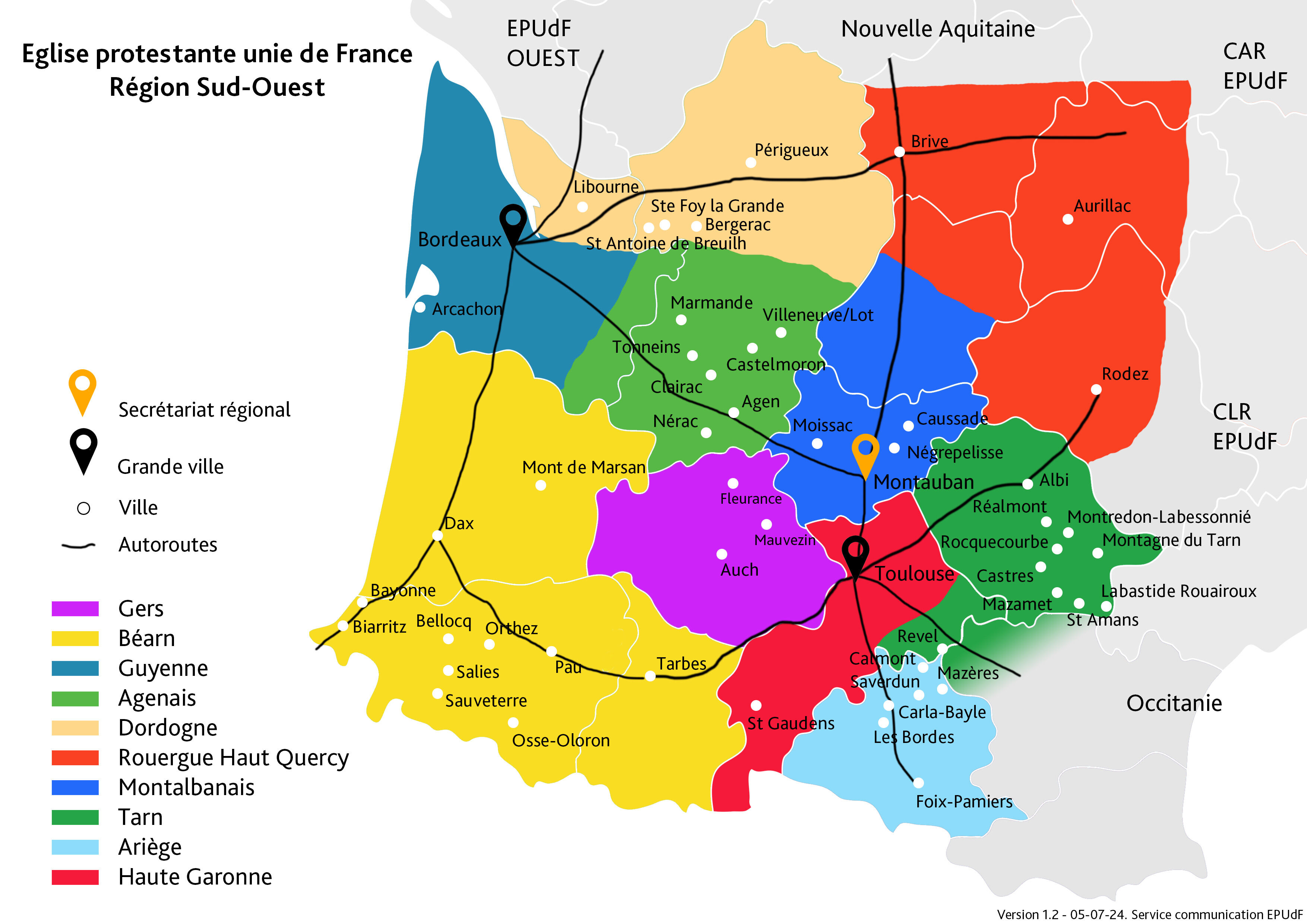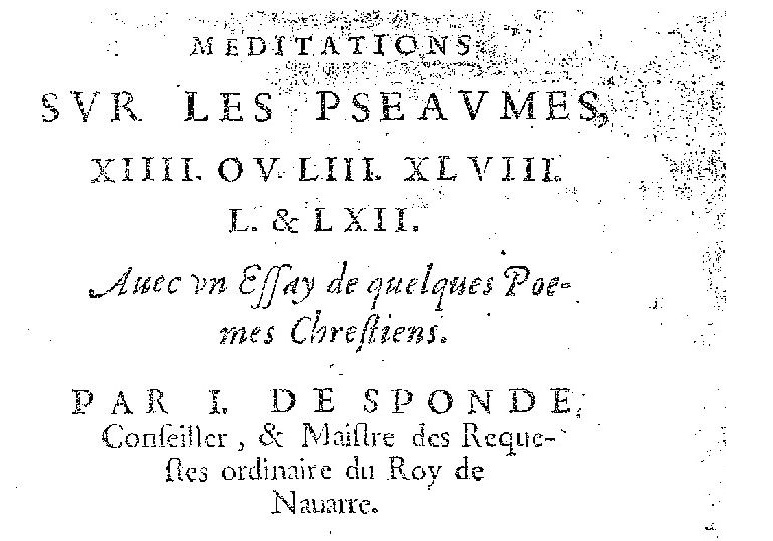Faut-il adhérer à la Fédération Protestante de France?
Le Conseil national de l’EPUdF s’est réuni du 19 au 21 septembre 2025 à Paris. Parmi les sujets à l’ordre du jour figurait un projet de modification des statuts de la Fédération protestante de France (FPF) pour donner davantage de place aux Églises évangéliques. Cette initiative a incité Nina Liberman à questionner la pertinence du système fédératif.