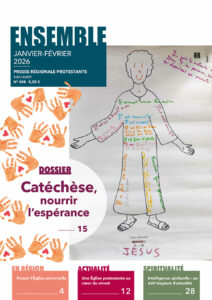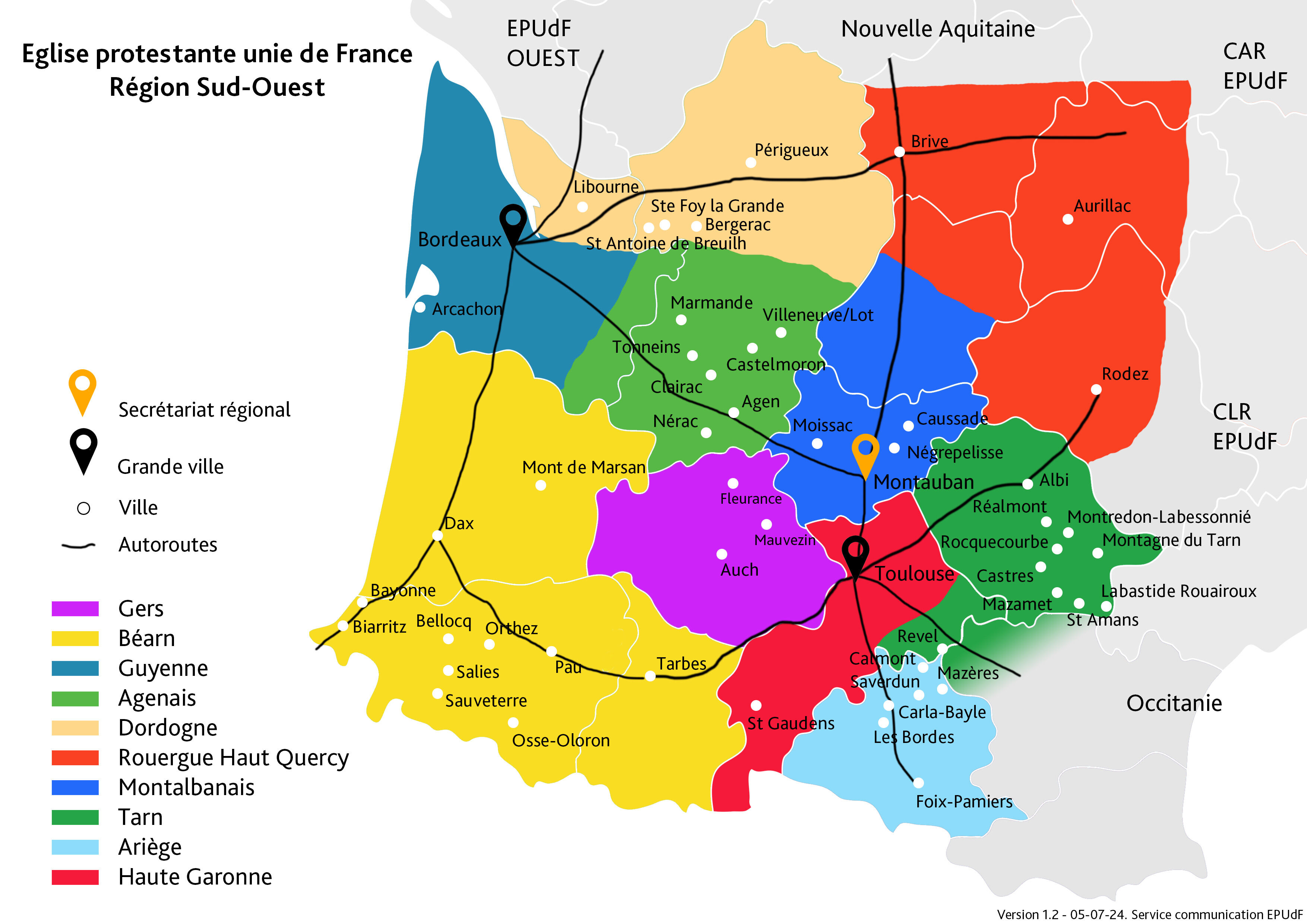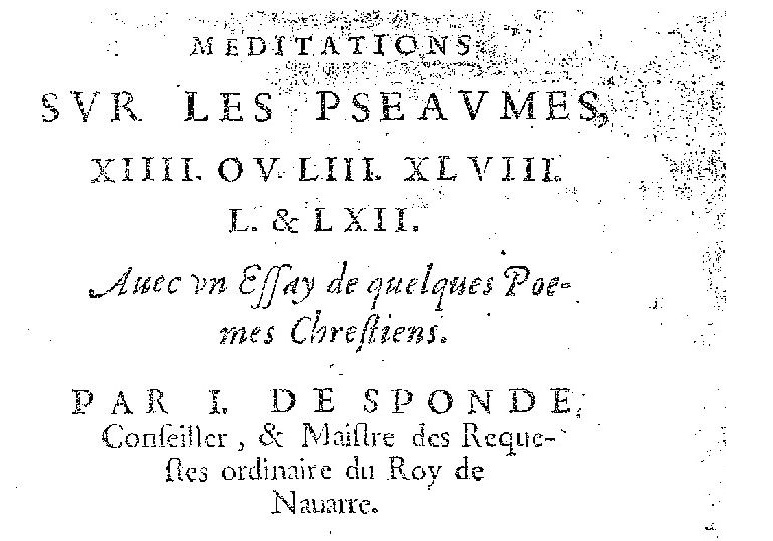La question mérite d’être posée, tant nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à n’y voir qu’une source de souffrances : dans la fonction publique, soignants et enseignants – parmi d’autres – peinent à trouver du sens à leur métier ; les ouvriers nourrissent un sentiment toujours plus assuré de n’être qu’une variable d’ajustement ; dans les entreprises, un sentiment d’isolement gagne les salariés jusqu’aux cadres ; l’auto-entreprenariat séduit de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas vivre l’usure et les angoisses de leurs parents sans leur garantir une stabilité. La précarité, la décomposition – des tâches comme des relations professionnelles – gagne partout du terrain, au point que la France est devenue « la championne européenne des dépressions liées au travail », comme le rapportait en avril dernier Les Échos.
Comme la solution ne viendra pas de l’État, c’est aux travailleurs de se sauver eux-mêmes, avant que le travail ne leur devienne, comme le corps d’insecte de Gregor Samsa, un carcan monstrueux dans lequel ils ne reconnaîtront plus leur forme humaine. Mais là est tout le danger : si se sauver veut dire fuir dans le chacun pour soi – et c’est parfois un impératif de santé –, c’est une autre métamorphose qui nous guette, celle d’un égoïsme qui ne fera qu’accentuer l’effritement de notre société.
Sommaire d’Ensemble nº404, septembre 2025