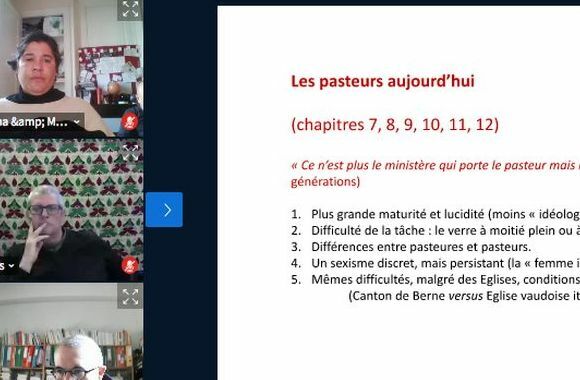Dans un entretien récent, Anne Soupa, bibliste catholique, osait dire sa reconnaissance à Martin Luther qui a pourtant si profondément ébranlé l’unité (supposée) de l’Église : « Je pense que tout catholique devrait lui être reconnaissant, car il a sauvé le catholicisme. Sauvé du risque inhérent à toute institution : prendre le pouvoir et oublier au nom de qui on l’exerce. Et je suis émerveillée qu’il ait ressuscité le sacerdoce commun des fidèles, si étouffé par la hiérarchie catholique. » (www.accueilradical.com, le 21 février 2020)

Reconnaissance pour les apports de l’autre
La première lecture de cet article m’avait laissé plutôt reconnaissant qu’une personne de l’autre Église ose ainsi dire, en toute simplicité, la dette théologique et spirituelle qu’elle avait à l’égard de l’un des nôtres… Un peu de lucidité m’oblige à témoigner ici, à mon tour, de ma propre reconnaissance pour les mots d’Anne Soupa et de ma dette spirituelle et théologique à son égard.
D’aucuns pourraient dire que le sacerdoce universel est une chose bien vécue dans nos Églises ; il est vrai que la direction de l’Église est partagée entre laïcs et pasteurs. Les laïcs peuvent exercer toutes les responsabilités et pratiquer tous les actes ecclésiaux, qui ne sont plus l’apanage des seuls pasteurs. Mais, le « risque inhérent à toute institution » menace nos communautés et notre institution autant qu’il menace les catholiques.
Entre les mains de quelques-uns
Par ailleurs, la façon dont se sont déroulées les récentes élections des conseillers presbytéraux dans notre Église m’a quelques fois laissé perplexe. Une proportion non négligeable d’Églises locales ont demandé (en région Centre-Alpes-Rhône, tout au moins) des dérogations pour revoir à la baisse le nombre de conseillers à élire. Ces demandes ont témoigné de deux difficultés que les conseillers sortants ont évoquées : l’attrition du nombre de membres de l’Église locale souhaitant s’engager était pour beaucoup due, d’une part, à la surcharge du petit nombre ayant effectivement les mains dans le cambouis et, d’autre part, à la complexité galopante des exigences administratives pour faire vivre les associations cultuelles. Ces difficultés soulèvent pour moi quelques questions liées au risque souligné par Anne Soupa. Comment sortir de cette complexification qui, de fait, enferme les décisions entre les mains d’un petit nombre, seul à même de maîtriser les tenants et les aboutissants du fonctionnement de l’Église ? Le pouvoir n’est-il pas ainsi, d’une certaine façon, confisqué, même involontairement ? Et puis, ne sommes-nous pas tombés dans une forme de cléricalisme lorsqu’une seule personne dans une communauté exerce les fonctions de trésorier, les engagements de catéchète et prédicateur, organise le repas paroissial annuel et passe de plus le coup de balai mensuel au temple tout en le fleurissant ?