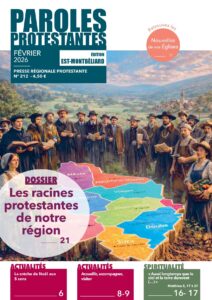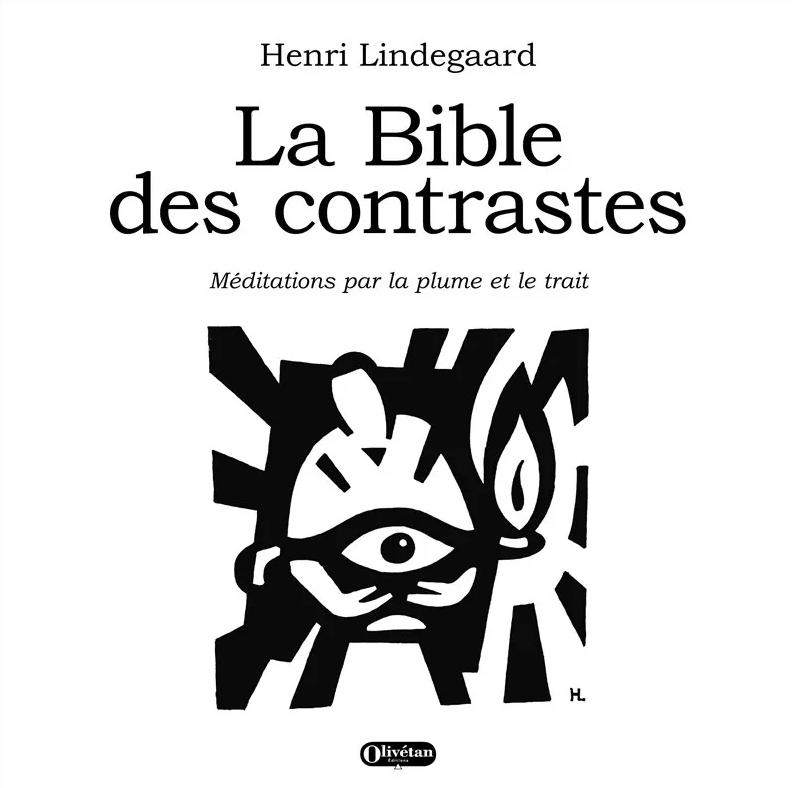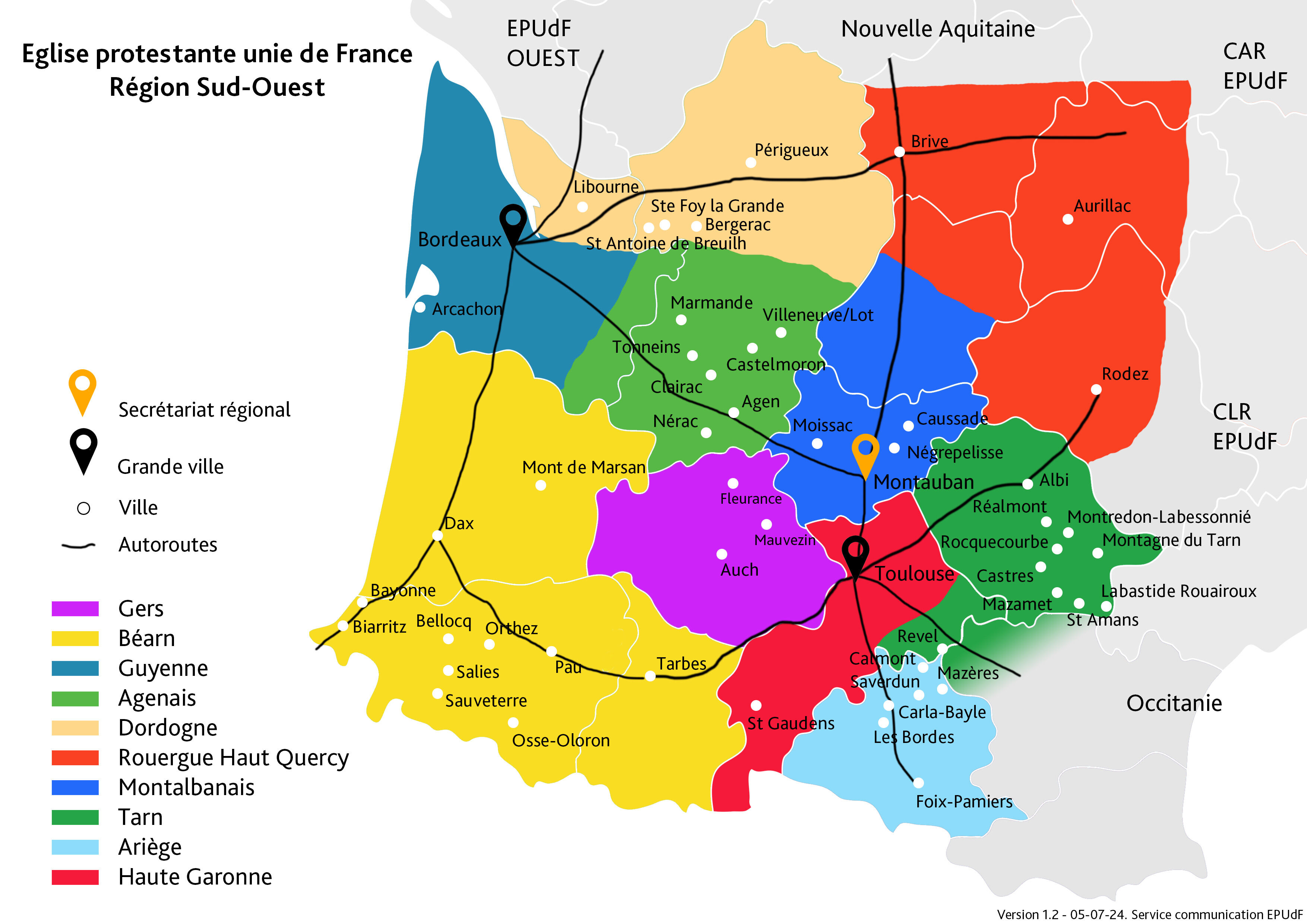Temple de St. Julien, vallée du Rupt ©Roger Bouillet
En effet sur l’ensemble de la Vallée, il n’y a plus guère qu’une dizaine d’exploitations agricoles et les fermes ne se trouvent plus au cœur des villages, comme cela était le cas dans un passé pas si lointain. Les troupeaux ne traversent plus les rues et plus personne ne se rend à la ferme avec son bidon à lait. En quarante ans, la Vallée du Rupt a vu disparaître deux tiers de ses exploitations agricoles et la tendance n’est pas prête d’être inversée.
La cohabitation entre les paysans et les nouveaux venus dans les villages n’est pas forcément des plus aisées. Dans certaines communes, le cultivateur doit laisser une bande de terrain, à prélever sur ses terres, libre de toute intervention à proximité des habitations, et plus précisément des pavillons nouvellement construits. Bertrand Bainier, dans la conversation, lâche le concept fondamental de « néo-ruraux » pour caractériser les citadins ayant décidé de quitter les communes urbaines, mais pas forcément la mentalité qui y correspond. La méconnaissance de leur nouvel espace de vie peut parfois entraîner des problèmes de voisinage. On oublie souvent que la campagne telle que nous la connaissons est le résultat du travail des hommes. L’arrivée des néo-ruraux bouleverse la composition sociologique d’une commune – et donc d’une paroisse. Et nous voilà conduits à évoquer un nouveau concept, la « gentrification », soit le processus par lequel la population indigène d’un village fait place à une population plus aisée, mais plus du tout enracinée ; on peut parler d’un embourgeoisement, ou plus péjorativement d’une « boboïsation ». Bertrand Bainier est dans la cinquantaine et il devrait consentir à de gros investissements pour renouveler ses équipements frappés d’obsolescence. Personne de sa famille ne reprendra son domaine qui, selon toute vraisemblance, sera racheté par l’un de ces regroupements agricoles que Bertrand qualifie de kolkhozes. Et pourtant, Bertrand appartient à cette race de passionnés qui ont compris que rien ne se fait de bien sans un lien particulier entre l’éleveur et l’animal ; le cultivateur, en outre, est architecte du paysage et son travail permet à la nature de réaliser tout son potentiel. Sans paysan, la Vallée perd son âme. Edwige, épouse de Bertrand et conseillère presbytérale, relève que l’Évangile reste un livre fermé pour celui qui n’entretient plus de contact avec la nature.
Et voilà que notre entretien tourne autour de l’ouvrage Cosmos du philosophe Michel Onfray qui cherche à renouer avec la sagesse de tous les lieux et de tous les temps : il s’agit à la fois de contempler le monde, de comprendre ses mystères et les leçons qu’il nous donne ; il importe aussi de ressaisir les intuitions fondatrices du temps, de la vie et de la nature…
Si, comme le relève Bertrand, il est nécessaire que les paysans soient représentés dans le monde politique, à combien plus forte raison ont-ils leur place dans nos paroisses, avec leur vision à la fois enracinée et spirituelle du monde, dont ils prennent soin pratiquement.
Il est vrai que la paysannerie et l’Église en France connaissent une destinée et des défis semblables : il n’est plus possible de répéter ce qui s’est toujours fait, mais il est hors de question de sacrifier, ni même de brader l’essentiel.