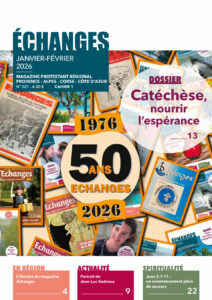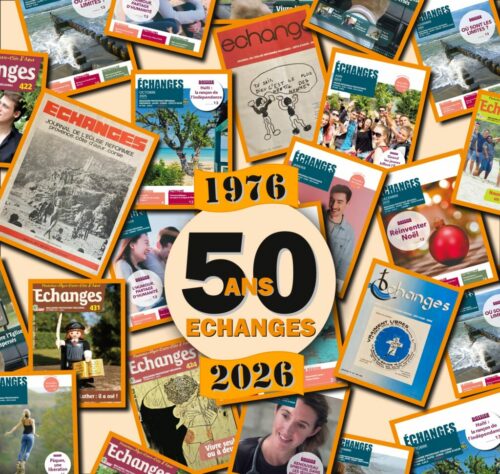© DR
Depuis la signature des Articles Organiques en avril 1802 par le Premier Consul Napoléon Bonaparte, qui organisent l’exercice des cultes catholique et protestant, les protestants marseillais jouissaient enfin d’une totale liberté de culte avec deux pasteurs rétribués par l’État. Pendant vingt ans, le culte est célébré dans une ancienne salle de concert au 10 de la rue Venture actuelle. On s’en contente malgré un accès difficile et un loyer élevé. C’est le ministre de l’Intérieur, Lainé, qui suggère à Marseille, comme ailleurs, de construire de véritables édifices.
Des projets seront établis à partir de 1821. Le consistoire retiendra celui de l’architecte en chef du département, Michel-Robert Penchaud, à qui l’on doit également l’Arc de triomphe de la porte d’Aix avec la perspective sur le Prado. Un terrain est trouvé rue Grignan appartenant à une famille Payan et l’autorisation de construire est facilement accordée, bien que l’on soit dans la période la plus conservatrice de la Restauration – c’est le règne de Charles X.
Une architecture néo-classique
Le projet de Penchaud consiste à édifier un monument à l’architecture néo-classique, ayant une façade de temple grec comportant quatre colonnes cannelées de style dorique, avec au-dessus de la porte principale l’inscription « Au Christ Rédempteur », une nef de plan basilical comportant 12 colonnes supportant une tribune, un même nombre de colonnes au premier étage – moins hautes – supportant le plafond. Une tribune intermédiaire sera ajoutée par Henri Espérandieu en 1868, ce qui portera le nombre de places à 800. De grandes verrières au plafond laissent pénétrer la lumière. L’abside est dominée par une belle chaire monumentale. Pour mener à bien les travaux, malgré des subventions publiques et de nombreux dons des fidèles, on devra faire un emprunt dont le remboursement ne cessera qu’en 1840.
L’inauguration a lieu le 9 octobre 1825 en présence d’une grande affluence, mais aucune autorité départementale et municipale n’a répondu à l’invitation. On devait penser que, le culte protestant ayant désormais son temple, c’était une reconnaissance suffisante…
Le protestantisme marseillais au XIXe siècle
À cette époque, le protestantisme marseillais est très divers. À côté de riches notables – négociants et armateurs – il se compose d’artisans et d’ouvriers venus des Cévennes, du Languedoc, du Dauphiné, d’étrangers issus de nations protestantes, Suisses, Anglais, Hollandais, Européens d’Europe de Nord, Vaudois du Piémont, tous attirés par un essor économique sans précédent qui trouvera son épanouissement sous le Second Empire. Au cours du siècle, sous l’impulsion du mouvement du « Réveil », des campagnes d’évangélisation attirent des milieux populaires, si bien que des salles s’ouvrent dans des quartiers excentrés.
Pendant tout le siècle et au-delà, le temple de la rue Grignan restera le coeur du protestantisme marseillais. Lorsque des paroisses nouvelles se créeront au cours du XXe siècle au fur et à mesure du développement de la ville, un seul conseil presbytéral continuera de les réunir pour une gestion commune, chacune ayant en propre un Conseil dit de paroisse pour les animer et affirmer leur spécificité. Lorsqu’elles accéderont à une pleine autonomie en 1986, un consistoire sera spécialement créé pour maintenir la nécessaire unité de la « Réforme » à Marseille.
200 ans de protestantisme à Marseille