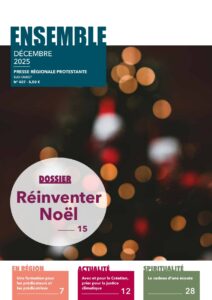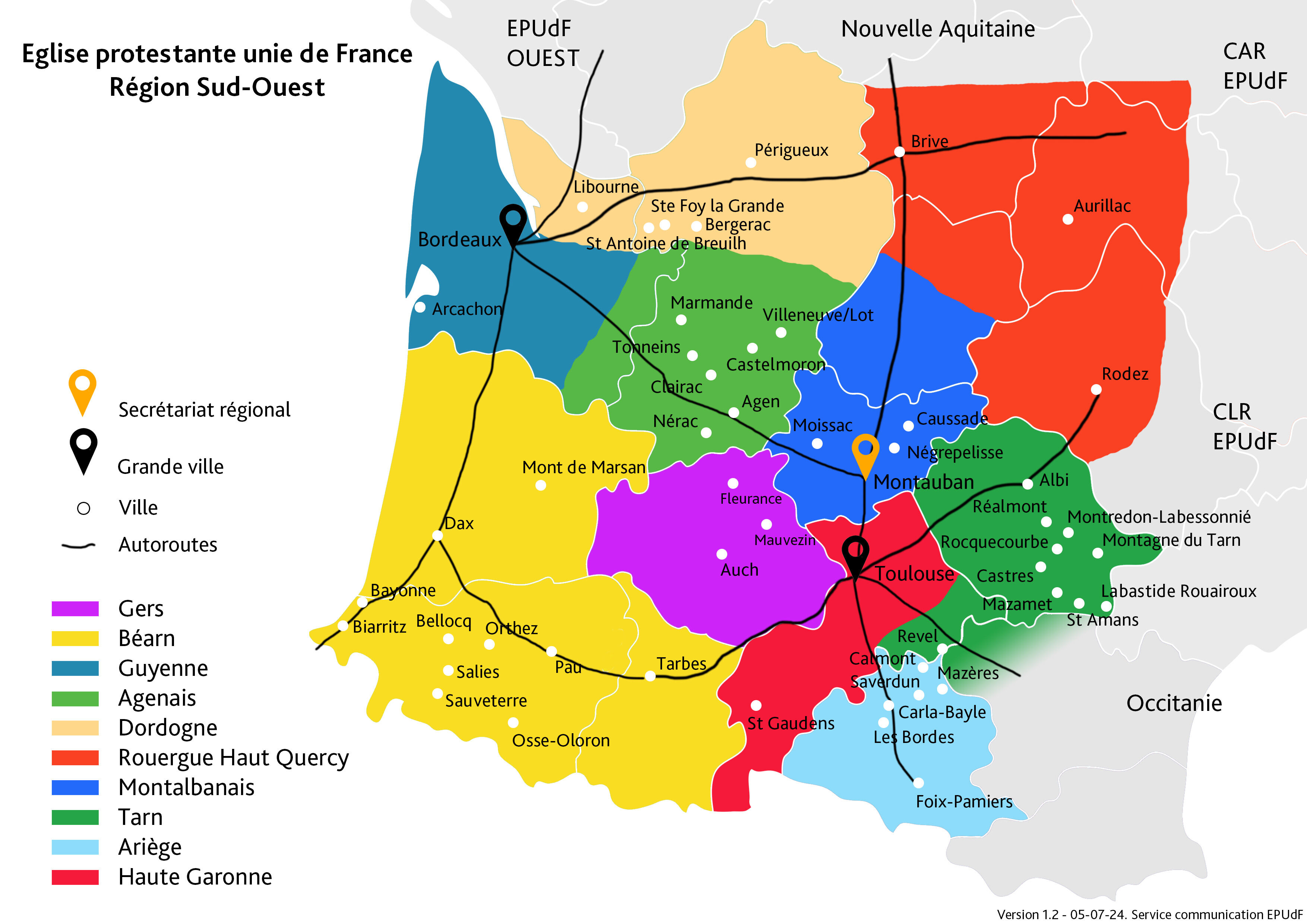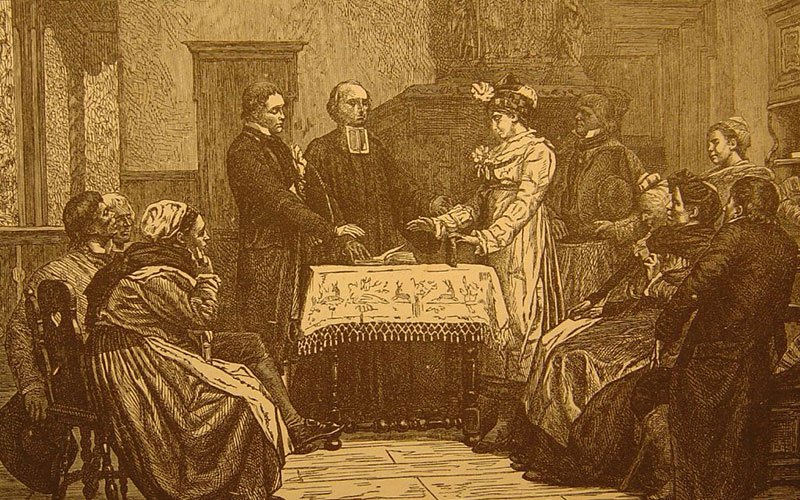© Priscilla du Preez/Unsplash
Parfois dépassés par la multiplicité de leurs tâches, voire tiraillés entre leurs besoins personnels, leur vie familiale et leur vie professionnelle, combien de pasteurs ressentent de la solitude et/ou tombent dans l’épuisement professionnel, voire quittent le ministère après quelques années de service, avec le sentiment d’un échec personnel, faute de n’avoir pas suffisamment exprimé le besoin d’être accompagnés ?
Enjeux de la supervision
La supervision pastorale s’appuie sur le postulat que toute personne qui exerce un travail de relation, d’écoute et de parole a besoin à son tour d’avoir un vis-à-vis qui l’écoute et l’accompagne avec bienveillance. Elle s’enracine dans cette assurance que chaque être humain est aimé de Dieu et appelé, tout comme Abraham, à devenir un sujet vivant en osant quitter le connu, remettre en question son cadre de référence professionnel ou personnel, pour aller vers devant, vers les autres, vers demain.
Depuis 2021, ce dispositif encourage les pasteurs de l’EPUdF à bénéficier d’un espace régulier d’échange, d’écoute et de relecture de pratique. Il est à différencier de l’accompagnement spirituel, qui consiste à écouter attentivement la personne dans la recherche du sens de son histoire et à l’aider à replacer sa vie sous le regard de Dieu et à la lumière de la Parole. La supervision pastorale contribue au bien-être des ministres : elle crée de l’espace, de la respiration, dans l’ici et le maintenant d’une rencontre pour laisser émerger du nouveau, des questionnements, une parole dense qui fait vivre, qui déplace et ouvre vers l’essentiel, la confiance en soi, en l’a(A)utre.
Une démarche responsable
La supervision est un service pris en charge par l’EPUdF. Certains superviseurs ont un ancrage dans l’Église, d’autres n’en ont aucun, mais tous sont respectueux de la spiritualité de la personne accompagnée et respectent une charte éthique qui renvoie à des valeurs partagées d’ouverture, de bienveillance, de respect et de confidentialité. Leur travail consiste à accompagner la personne pour qu’elle soit active dans son processus de développement et de transformation, avec son propre regard, sans lui donner de réponses toutes faites ni lui demander de mettre en œuvre quelque chose qui a été pensé par d’autres.
S’engager dans un travail de supervision n’est pas le signe d’un mal-être pastoral. Bien au contraire, c’est une démarche responsable, selon moi, qui montre que le ministre prend soin de sa personne et du ministère qui lui est confié. En effet, la supervision apporte un réel soutien, en aidant à prendre du recul par rapport à des situations professionnelles complexes, à clarifier sa posture, à devenir acteur et force de propositions au lieu de subir des situations de maltraitance et/ou de violence au sein de l’Église, à différencier l’essentiel, le cœur de sa fonction, de l’urgent, autrement dit à prendre sa place de ministre dans l’Église où on est appelé à servir.
Il n’y a pas qu’une seule manière d’habiter le ministère pastoral et c’est précisément ce qui en fait son originalité. J’encourage mes collègues qui n’y ont pas encore goûté à faire ce pas. Les présidents de conseil régional et les inspecteurs ecclésiastiques peuvent mettre à leur disposition toute une palette de personnes ressources.