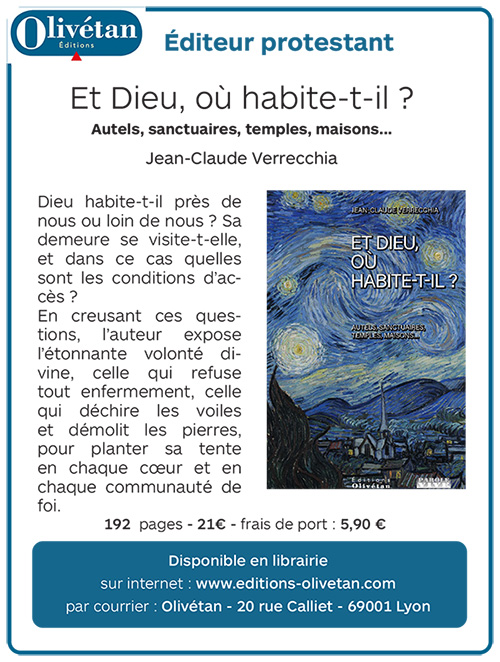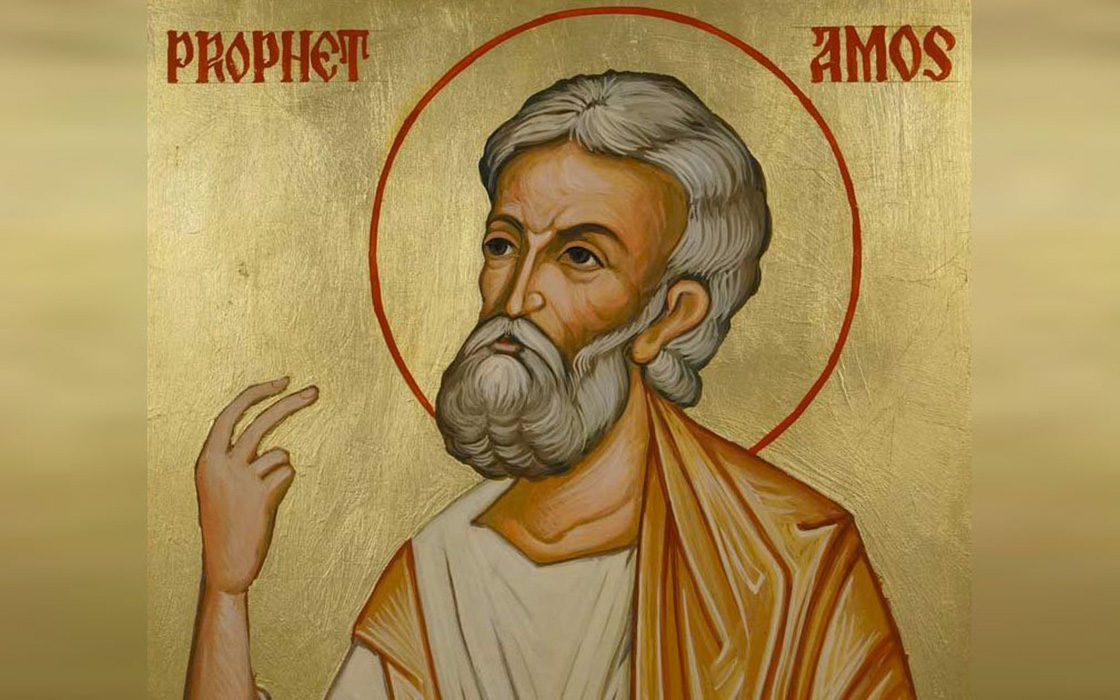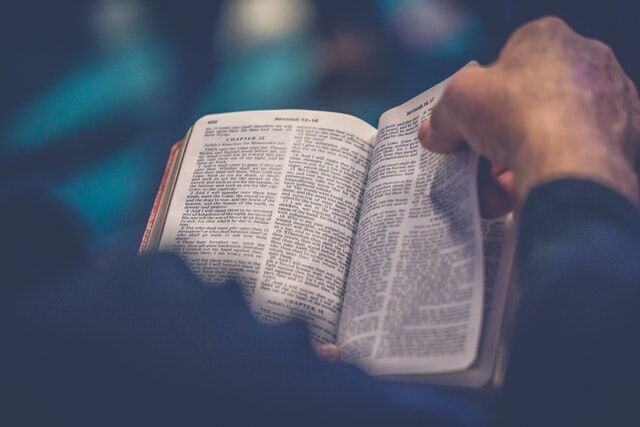Rien ne me choque davantage que d’assimiler un groupe de discussion à un groupe de travail, selon la terminologie en vogue ; mettre côte à côte discussion et travail relève de l’oxymore – une combinaison de deux termes contradictoires. Je me console en relisant les propos d’un autre bougon dont la réputation n’a plus à être flétrie : l’apôtre Paul. N’est-ce pas lui qui affirme péremptoirement : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Thessaloniciens 3.10) ? En un temps comme le nôtre où le travail se raréfie et où notre modèle social se trouve mis à mal, les propos de l’apôtre résonnent très désagréablement à nos oreilles. Le travail est placé à l’enseigne d’une concurrence effrénée, toutes nos activités deviennent fébriles et surexcitées. Chacun craint de perdre son emploi ou de voir ses revenus ou ses profits baisser. Le mot même de « solidarité » n’a plus cours et c’est chacun pour soi…
Le pasteur et moraliste Charles Wagner (1852-1918) écrivait : « Le travail est mal compris et même méprisé par beaucoup trop de gens. Il est surtout considéré comme une corvée à laquelle on se soumet pour gagner le pain. Celui qui a du pain n’a pas besoin de travailler. Quant à l’autre, il travaille par nécessité. Tous deux font mal. Je distingue deux espèces de fainéants, ceux qui paressent et ceux qui travaillent en grognant. »
Paul s’en prend violemment à ces fainéants qui ne se préoccupent plus de leurs conditions de survie ; ce choix d’existence leur dégage des loisirs qu’ils occupent en agitant des questions aussi futiles qu’inutiles. Ils ne se soucient aucunement de tomber à la charge de la communauté. La remise en ordre de ces frères considérés comme déviants est sévère. Persuadés de vivre les derniers temps du monde, ces croyants vivant dans le désordre de leurs pensées oisives ont tout simplement aboli les contraintes de la vie quotidienne. L’apôtre n’hésite pas à se mettre en avant : dans ses activités de missionnaire itinérant, il a souvent bénéficié de l’hospitalité, mais il ne s’est jamais gobergé aux frais de ses hôtes : il a toujours fourni des prestations en retour. À l’encontre de l’oisiveté pieuse, Paul pose la grande loi du travail comme mise en œuvre d’une vocation.
Il veut des chrétiens libres, indépendants, responsables et non des parasites. Il y a plus d’une façon de ne rien faire de son existence et nous ne devons pas hésiter à poser la question de la productivité de notre travail qui revêt une dimension spirituelle. Notre vie n’est pas la simple durée de notre existence ni un cycle purement végétatif ou animal d’événements – elle a pour vocation d’être succession et cohérence. Notre avenir le plus immédiat consiste en une tâche que nous discernons et assumons.
L’âme désigne traditionnellement cet aspect de notre être en contact avec Dieu ; ce contact permet de dégager nos potentialités. Évoquer l’âme, c’est dire que le cercle fermé de nos existences se trouve rompu afin de nous ouvrir à un travail sur nous-mêmes et donc à une nouvelle synthèse des éléments qui composent notre être et notre destinée. La grâce de Dieu ne s’oppose pas à notre nature, ni d’ailleurs à notre volonté ni surtout à notre activité : elle travaille à faire de notre vie une œuvre utile, belle et bienfaisante.
À l’encontre de l’oisiveté pieuse, Paul pose la grande loi du travail comme mise en œuvre d’une vocation