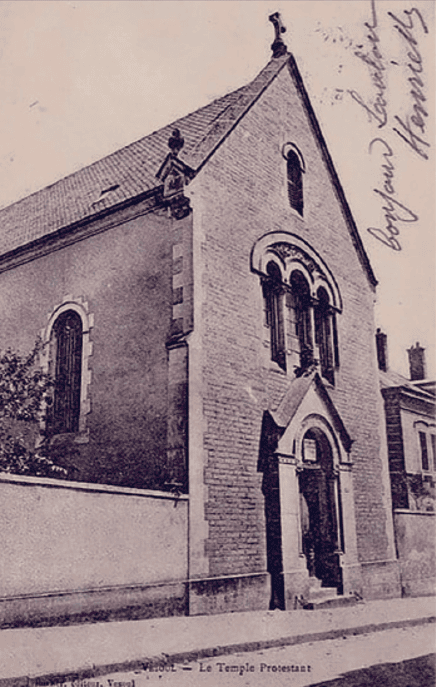Il n’y a pas si longtemps, la question aurait surpris. Malgré les dénégations, l’héritage chrétien de l’Occident était encore assez évident pour que l’on se souvînt, à l’occasion, que le mot « Noël » venait de natalis, « (jour) de naissance », et que c’est de Jésus qu’il s’agissait.

Des évolutions sociétales
Un Jésus apprivoisé, certes : le mythe romantique de l’enfance innocente en avait fait le représentant des bons sentiments dont Noël devait être le catalyseur annuel. Fête de l’enfance, de la famille, de l’amour, des pauvres : les associations charitables cherchaient sous l’épaisseur des cœurs élevés dans le culte de la consommation quelques restes de compassion. On pouvait encore convoquer les mélodies des cantiques les plus connus à renfort d’arrangement sirupeux, afin d’émouvoir le quidam au rappel des Noëls d’autrefois.
Autrefois… quand on était soi-même enfant, fasciné comme le papillon par les lumières de la fête, percevant dans la douceur des chants et le parfum des bougies quelque chose de la vérité de l’existence qui prenait provisoirement le pas sur les contraintes habituelles. Ces veillées-là étaient marquées d’une joie teintée de tristesse, d’une fête qui n’est pas divertissement, mais plongée dans l’essentiel. Ce soir-là, les familles voulaient goûter la paix d’être ensemble. Les cadeaux venaient presque la troubler, cette paix, faisant piaffer d’impatience les plus jeunes. Ils étaient « en trop ».
Mais on les attendait quand-même fébrilement : la joie du Noël « authentique » était déjà mêlée de la jouissance anticipée de toutes les choses dont on pourrait se remplir. Le Père Noël était déjà arrivé d’Amérique avec sa hotte pleine de rêves préfabriqués.
Un déracinement chrétien
Depuis, l’Occident s’est détourné plus volontairement de ses « racines chrétiennes ». L’indifférence au christianisme s’est largement muée en hostilité, même dans les pays traditionnellement religieux. Autre interprétation possible : les sociétés occidentales se débarrassent des dernières écailles du vernis religieux que l’histoire a badigeonné sur des mentalités collectives qui n’ont jamais été chrétiennes, au fond. De Noël, elles ont gardé la morale (promotion des valeurs humanistes) mais n’écoutent pas (si tant est qu’elles aient jamais écouté) le message : Dieu est pour toi, pas contre toi.
Rien ne sert de vouloir regagner des parts du marché culturel pour restaurer une chrétienté imaginaire – d’ailleurs, la confiscation de Noël par le monde sécularisé n’est-elle pas un juste retour de l’histoire, le christianisme ayant lui-même « emprunté » la fête au syncrétisme solaire au 4e siècle ?
Une histoire
Par contre, que Dieu soit pour toi et non contre toi, c’est le dépôt de la foi évangélique, trésor de l’Église qui grandit d’être partagé. Partager un trésor est plus excitant que lutter pour survivre. Comment cela peut-il se faire ? Trois suggestions, toutes simples :
– Noël est un des rares moments de l’année où le culte peut rejoindre si explicitement la culture. Je pense à la musique : là où les talents existent, il est facile d’offrir du plaisir aux oreilles tout en offrant l’Évangile aux cœurs ;
– mais Noël est d’abord une histoire. Concrètement, des textes, qu’il vaut la peine de lire. Un des ingrédients des veillées de Noël familiales était la lecture du récit de la Nativité. Cela peut se faire en Église de façon fort simple, comme se pratiquent des lectures de la Passion le Vendredi saint. Une manière de replacer le récit biblique au centre de Noël ;
– et enfin, les récits bibliques de la Nativité ne sont pas assignés à une période de l’année : rien n’interdit de les lire en plein été, dans les paroisses touristiques. Une manière, en décalant Noël, de replacer sa joie dans le cours ordinaire de la vie.