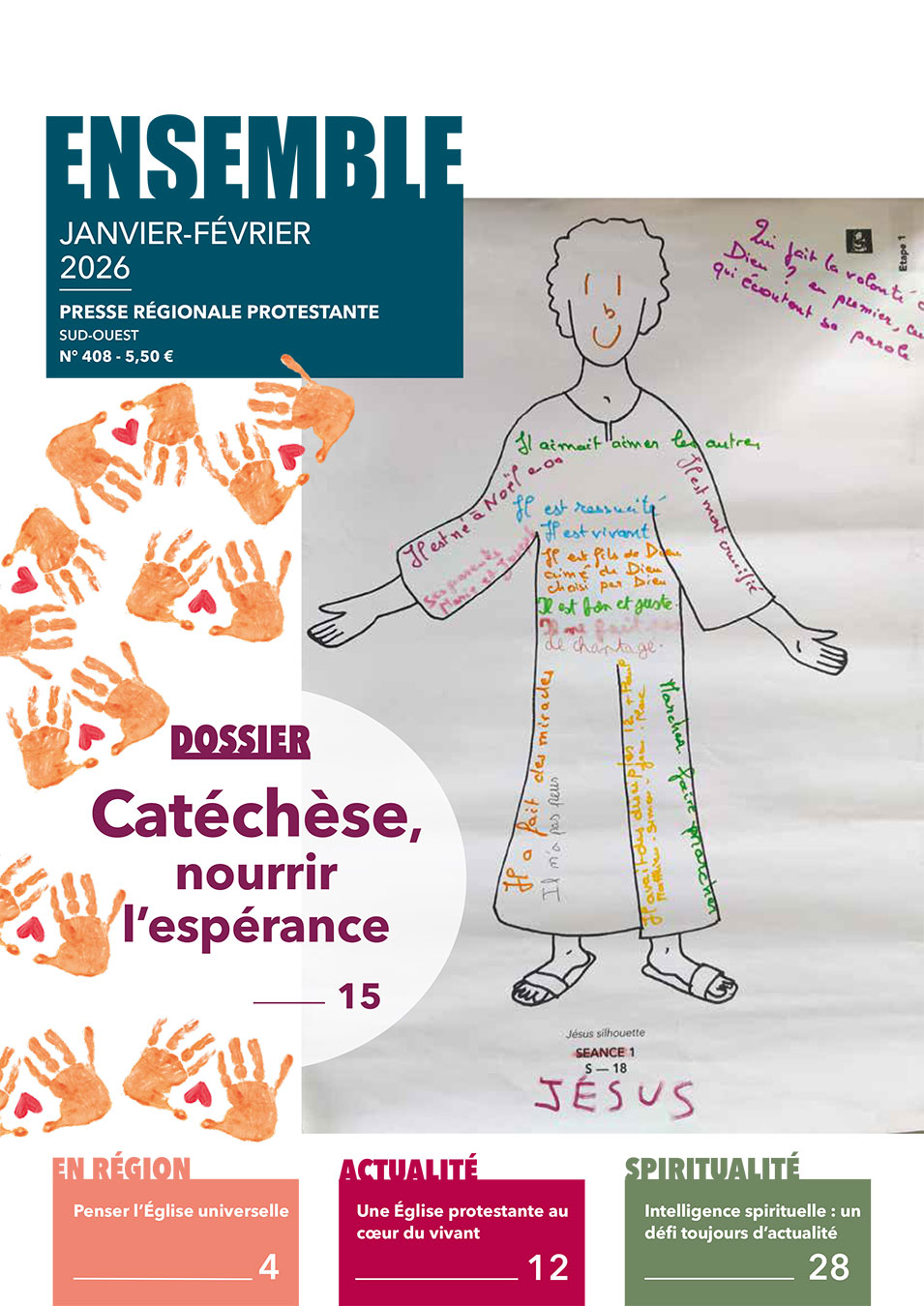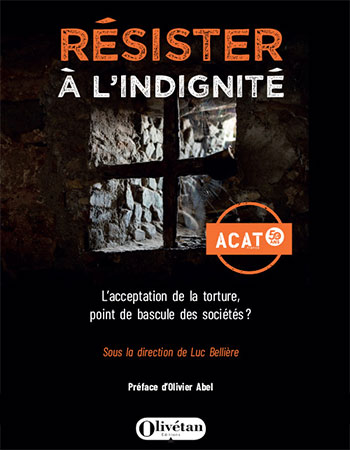Olivier Abel (DR)
Nous le sentons tous, à ce mélange d’effroi paralysant et d’excitation panique qui nous saisit souvent face aux actualités d’un monde assombri, nos sociétés se trouvent à ce point de bascule, longuement ausculté dans les pages ici réunies, par lequel elles risquent de plonger dans la barbarie. Qu’est-ce qui peut les en empêcher ? Comment résister à l’indignité ? Comment ne pas se laisser décourager, c’est-à-dire à la fois démoraliser et dépolitiser, face au sentiment d’un retournement de tous nos progrès en régressions massives ? Sur quoi reprendre appui ?
Il me semble bon, face à la nervosité présente, de reprendre une respiration plus ample en allant chercher assez loin, dans un passé qui peut nous paraître archaïque, les promesses encore inachevées d’un autre avenir, d’un horizon d’attentes moins bouché. Je reprendrai ici le sillage de ce qui me frappe depuis longtemps[1]. C’est l’idée que les Droits humains sont issus d’une longue histoire qui est à la fois celle d’une individualisation du divin et d’une sacralisation de la personne.
L’individualisation du divin, on la voit portée par la protestation d’Abraham ou de Job devant Dieu, une protestation qui est une contestation révoltée en justice (« pourquoi moi ? ») autant qu’une attestation de foi, de confiance (« comme tu voudras »), mais dont l’oscillation ne cesse d’aiguiser la singularité du sujet devant Dieu – cette oscillation est encore celle des dernières paroles de Jésus en croix. Mais l’individualisation du divin, c’est aussi le rejet des Dieux lointains et indifférents, notamment par Épicure qui invente le mot pistis (la foi en ce qu’elle a d’intime, de personnel), et la recherche du divin en nous, d’une sorte de subjectivation intime du divin, que l’on trouve intensément déployée dans les épitres de Paul ou les confessions d’Augustin. C’est parce qu’il y a eu une sorte de désacralisation de la nature, mais aussi une désacralisation des dieux de la cité, et que le divin s’est ainsi individualisé et intériorisé, que la personne est devenue sacrée. Lorsque Kant pose comme un impératif catégorique, c’est-à-dire inconditionnel, l’exigence de traiter l’humanité, en soi-même comme en autrui, toujours comme une fin et jamais comme un moyen, il formule la conséquence la plus lointaine, la plus universelle de cette histoire du divin, de l’humain – de l’image de Dieu. L’habeas corpus, l’abolition de l’esclavage, l’abolition de la peine de mort, l’abolition de la torture sont des effets de cette histoire.
Cette histoire est-elle épuisée ? Est-elle en train de vivre ses derniers moments, ses dernières variations, de plus en plus faibles ? Peut-être nous sommes-nous, dans notre civilisation hyper-individualiste, abusés sur l’importance des individus, bardés de droits, peut-être en avons-nous abusé ? Nous avons moralisé et individualisé à l’extrême le péché, nous avons réduit l’élan de la rédemption au recrutement d’élus solitaires[2], nous avons réduit la foi à un domaine purement privé, et la piété religieuse à un souci de soi – allô maman bobo… Peut-être fallait-il ébranler notre tranquille dépolitisation, pour comprendre l’ampleur et la profondeur de notre démoralisation ? Mais les deux sont inséparables, de même que la parole de chacun est inséparable du langage commun.
J’ai été frappé, au long de la lecture des textes ici réunis, de l’importance accordée aux manières de nommer. La torture est toujours préparée par un langage de déshumanisation. Il n’y a plus d’ennemi, car ce serait encore leur faire trop d’honneur, il y a des insectes ou des démons. Il n’y a plus d’opposant, car ce serait encore une manière d’accepter que ce soient des concitoyens, il y a des terroristes. Et la qualification de terroriste est déjà l’indice d’un régime de terreur, où les frontières de la démocratie et de la dictature s’estompent. Nos démocraties sont fragiles, parce qu’elles tentent d’intérioriser la conflictualité, au sein des institutions comme au sein des sujets eux-mêmes. Elles sont fragiles car elles acceptent la pluralité des affaires humaines, et la fragilité d’un langage politique toujours discutable. Dès que nous prenons peur de cette fragilité, de cette pluralité, de cette complexe conflictualité, la démocratie s’affaisse et s’effondre, comme un sol devenu mouvant. Nous prenons peur et nous confondons les institutions politiques avec la sacro-sainte Sécurité – avec ce désir d’être complètement protégé contre le mal, qui nous fait faire tant de mal. Ricœur écrivait que le langage est l’institution des institutions, et que la confiance au langage commun est le socle de la confiance aux institutions.
Au nom de quoi, donc, la torture ? Au nom de quel Dieu, de quelle idole ? Nous ne mesurons pas à quel point le Peuple a peu à peu pris la place de Dieu, seul souverain, à quel point nous avons réduit la légitimité de la démocratie à cette théologie politique entièrement sécularisée, invisible et indiscutable. C’est ce tabou qu’il nous faut déboulonner, et c’est ce théologico-politique qu’il nous faut déconstruire et démanteler, partout où nous le trouvons à l’œuvre. Dans son combat contre l’idole du IIIe Reich, à la fois violent et menteur, Karl Barth stigmatisait non seulement la lâcheté du peuple mais sa crédulité – sa complaisance à se laisser flatter, à croire tous les mensonges, à ne pas chercher à s’informer. On peut bien dire que nous en sommes à nouveau à ce point.
Reprenons d’abord le travail incessant de l’argumentation contre les sophismes. Des deux principaux arguments en faveur de la torture, le premier est qu’elle fait parler, que c’est une technique de renseignement. Mais déjà, jadis, Pierre Bayle avait longuement argumenté contre tous les aveux obtenus par la force, dans son traité de la tolérance (de son vrai titre Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contrains les d’entrer, 1686), en montrant que ce ne pouvait être qu’une fabrique de mensonges et d’hypocrisie. Le second argument est celui du moindre mal. Mais là aussi Bayle avait montré les effets passionnés de la violence, car on déteste ceux à qui on fait du mal, et cette haine fait du mal en plus, en ajoute, augmente le mal, et entraîne tout le monde dans ce mal.
Au cœur de la torture, de la question qu’elle nous pose à tous, je voudrais cependant à nouveau placer celle de l’humiliation, en tant qu’elle vise à briser tant la dignité intrinsèque de la personne que les liens qui l’attachent au monde humain. Il y a l’humiliation verticale qui écrase l’autre dans la servitude, et l’humiliation horizontale qui éjecte l’autre devenu inutile. Dans la torture, il est impossible de s’enfuir, il n’y a plus d’abri protecteur, plus de retrait possible. Le sujet torturé est entièrement exposé, dans sa vulnérabilité. On l’exprime malgré lui, on lui fait exprimer ce qu’on veut. Mais dans le même temps, dans la torture, on est rejeté en dehors du corps social, on est jeté, rejeté, mis au rebut, comme un déchet. Le sens le plus profond de la torture est sans doute moins de faire parler que de faire taire. C’est peut-être la meilleure définition de l’humiliation, que ce qui fait taire. Et de nous blinder, de nous insensibiliser aux humiliations qu’à notre tour nous risquons de faire subir aux autres.
Je ne suis pas le premier à parler d’humiliation, et c’est d’ailleurs ainsi que Ricœur terminait sa fameuse conférence à l’assemblée générale de l’ACAT à l’université Charles de Prague le 5 octobre 2005 : « derrière le faire souffrir se cache l’humiliation qui voudrait que l’autre persécuté perde le respect de soi, se méprise[3] ». Le présupposé de la torture, c’est que le sujet est identique à ses actes, à ses paroles, à ses engagements, qu’on peut l’y enfermer et l’y incarcérer, au sens propre, jusqu’à ce que son corps lui-même en face l’aveu, et qu’il soit ensuite jetable. Mais le sujet y est irréductible, et comme le disait jadis Bayle, « les droits de la conscience sont directement ceux de Dieu lui-même[4] ». Notre résistance à l’indignité, c’est certes d’abord la faculté de tenir nos promesses : « Qui suis-je, moi si versatile, pour que néanmoins tu comptes sur moi ? » disait Ricœur dans Soi-même comme un autre[5]. Mais c’est aussi de penser que le sujet a le pouvoir de se délier des promesses devenues mortelles, de pardonner, et de se lier par des liens nouveaux, qui libèrent des anciens, de se lier par de nouvelles promesses. Ces deux facultés, de pardonner et de promettre, dont Jésus n’a cessé de dire qu’elles appartiennent à tous, sont éminemment politiques.
[1] « Les origines et l’espérance des Droits de l’homme », en deux parties in Autres Temps n° 11 et n° 12, janvier et mars 1987.
[2] Voir de Paul Ricœur le texte de sa conférence de 1960 devant les mouvements du Christianisme social, « L’image de Dieu et l’épopée humaine », repris dans Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1964 (poche).
[3] Paul Ricœur, « Fragile identité : respect de l’autre et identité culturelle », conférence de Ricœur à la FIACAT 2000 à Prague, p. 46.
[4] Pierre Bayle, Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contrains les d’entrer, in Œuvres Diverses, t. 2 (La Haye-Trévoux : seconde édition 1737), p. 379-b.
[5] Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, au dernier paragraphe de la sixième étude.
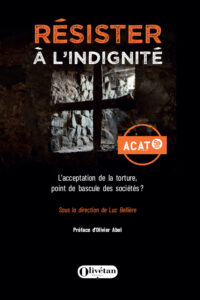
Résister à l’indignité – L’acceptation de la torture, point de bascule des sociétés ?, Olivétan, février 2026, sous la direction de Luc Bellière, président de l’ACAT-France