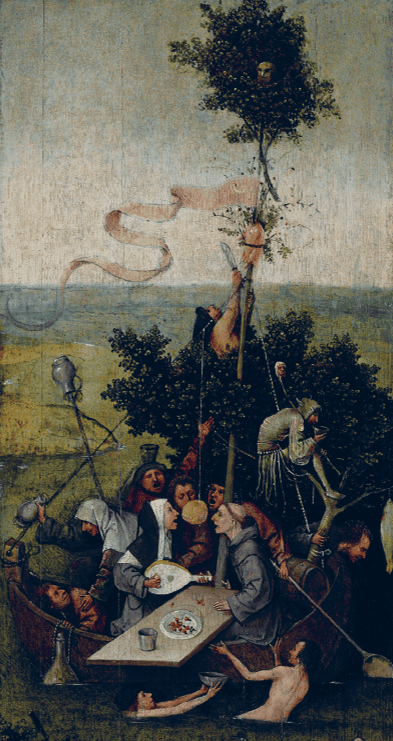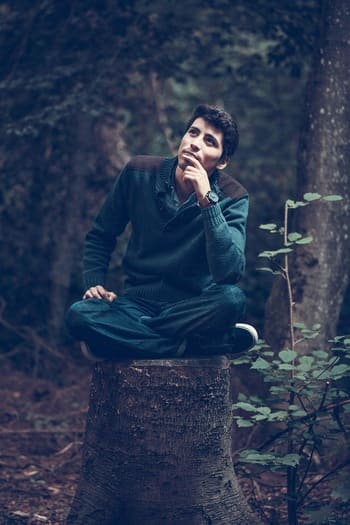© Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez/Wikimedia commons
C’est une protection de l’enfance sinistrée que décrit la commission de l’Assemblée nationale dans son rapport publié le 1er avril dernier. Elle y déplore le désengagement continu de l’État alors que les effectifs des mineurs placés augmentent chaque année – dans certains départements, ils ont parfois quintuplé en dix ans. Ainsi, le rapport note que « les dépenses totales de l’ASE ont augmenté de 61 % depuis 1998 », quand l’État participe « à hauteur de 3 % seulement du financement des 10 milliards d’euros dépensés pour la protection de l’enfance chaque année ». L’effort repose donc sur les départements, ce qui implique des financements inégaux en faveur des enfants.
L’ASE rencontre également d’importantes difficultés de recrutement : ni les conditions de travail ni le salaire ne rendent aujourd’hui le métier d’éducateur attractif. Sans moyens suffisants, contraint de s’occuper des enfants dans des conditions parfois catastrophiques – l’hébergement en hôtel quand les places en foyer font défaut, en dépit de la loi votée en 2022 qui l’interdit –, le personnel en poste ne sait plus comment protéger efficacement les enfants qui lui sont confiés. Le recours à des agents intérimaires employés en contrats courts dégrade encore la qualité de l’accueil et/ou du suivi des mineurs placés. Autant de défaillances qui fragilisent l’ASE et la rende perméable à la prédation de proxénètes qui n’hésitent plus, selon le rapport, à recruter au sein même des structures d’accueil.
Le rapport de la commission pointe la part massive des enfants placés parmi les victimes de prostitution. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, 75 % des mineurs prostitués vivent dans un foyer de l’ASE
Un phénomène européen
En France, on estime qu’environ 15 000 mineurs de l’ASE sont concernés par la prostitution. Il s’agit en grande majorité de jeunes filles âgées de 13 à 17 ans. Leurs profils ont souvent un point commun : elles ont déjà connu des violences (familiales et/ou sexuelles) et présentent une grande vulnérabilité. Elles sont la proie de proxénètes déclarés qui leur vantent une image mensongère de la prostitution, mais aussi des mal nommés loverboys, de jeunes garçons majeurs qui nouent des relations amoureuses avec elles pour les prostituer ensuite. Ce phénomène touche aujourd’hui la plupart des pays d’Europe. Ces loverboys peuvent aussi venir des réseaux de la drogue et utiliser les jeunes filles pour fidéliser leur clientèle, en proposant des faveurs sexuelles gratuites en échange d’achat de drogue en grande quantité ou pour compléter leurs revenus.
Les services de police tout comme les associations de mères cherchant à sortir leur fille de la prostitution sont la plupart du temps démunis pour y faire face : les rencontres étant fixées sur des sites érotiques destinés à des adultes consentants ou sur des réseaux sociaux, dans des appartements loués sur Airbnb ou des squats abandonnés, aucune illégalité apparente ne permet d’intenter d’actions contre les proxénètes, d’autant plus que les jeunes filles sont très souvent dans le déni de leur propre prostitution. La police compte donc sur l’action des structures sociales pour prévenir ce problème, ce qui semble malheureusement très au-dessus de leurs moyens actuels.