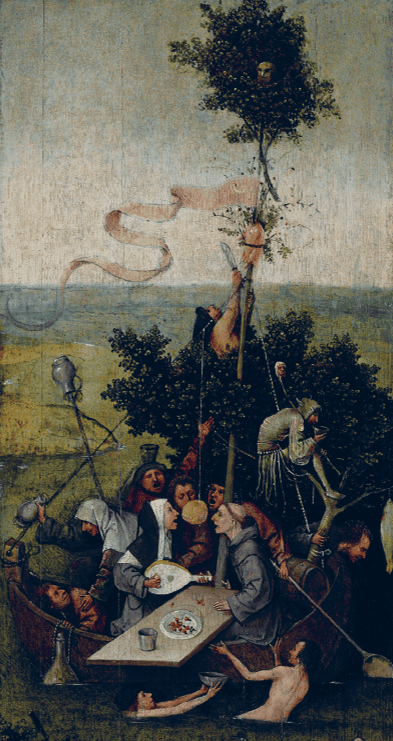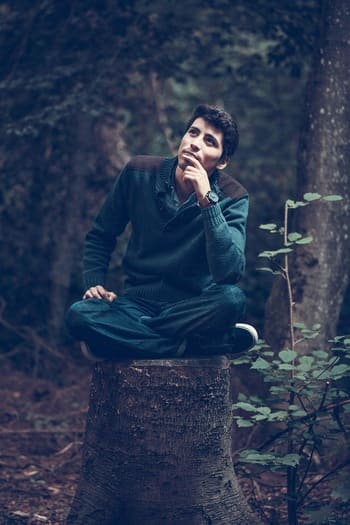© Stéphane Vaquero
© Stéphane Vaquero
Le 10 mai 2026, nous commémorerons le 25e anniversaire du vote de la loi Taubira, par laquelle la France est devenue le premier pays à reconnaître l’esclavage et la traite comme crime contre l’humanité. C’est en effet le 10 mai 2001 que, après l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté la proposition de loi présentée par Christiane Taubira, alors députée de Guyane et rattachée au groupe socialiste que je présidais.
Ce vote unanime a marqué une étape majeure dans la reconnaissance par la France de cette part sombre de son histoire. Il a été décisif pour la faire entrer dans les programmes scolaires ; il a largement contribué à l’essor de la recherche sur l’esclavage et ses héritages ; il a vu enfin la naissance d’une véritable politique mémorielle nationale sur l’esclavage colonial, structurée autour de deux journées nationales (les 10 et 23 mai) et animée par une institution nationale, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, que je préside depuis sa création en 2019.
La loi Taubira a également accompagné un mouvement mondial qui a abouti, quelques mois plus tard, à l’inscription de cette qualification de « crime contre l’humanité » attachée à l’esclavage et à la traite dans la déclaration finale de la conférence de Durban contre le racisme. Mais pour les pays qui en ont été victimes, pour leurs populations, ainsi que pour les diasporas qui en sont issues, cette affirmation va bien au-delà : elle rappelle aussi la persistance des héritages négatifs de cette histoire (racisme, inégalités, exploitation) et nourrit une demande de réparations de ces préjudices toujours sensibles aujourd’hui.
Un sujet mondial
Cette revendication n’a fait que se renforcer depuis 2001 : les États de la Caraïbe, dont la majorité des habitants descendent des Africains déportés et réduits en esclavage par les puissances coloniales européennes, l’ont traduite en 2014 dans un plan de réparations en dix points porté par leur organisation régionale, la Caricom. Les organisations du système des Nations unies, par la voix de plusieurs de leurs responsables comme Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, ou Volker Turk, le haut-commissaire aux droits humains, ont depuis plusieurs années repris cette demande dans des déclarations publiques. Et après la Caricom, d’autres États ont formulé de telles demandes : la communauté des États latino-américains et caraïbes en 2023, une majorité des États-membres du Commonwealth lors du dernier sommet de l’institution en 2024, l’Union Africaine en 2025.
La question des réparations de l’esclavage est ainsi devenue aujourd’hui un sujet de discussion mondial, que les anciennes puissances coloniales ne peuvent plus esquiver. Mais, dans ces pays, et notamment dans le nôtre, elle suscite encore l’incompréhension, voire la crainte et l’hostilité : l’esclavage colonial ayant été aboli par la France en 1848, il y a plus de 175 ans, qu’y aurait-il donc encore à réparer ? À qui verser ces réparations ? Et qui devrait les payer ? Ces questions sont légitimes ; mais il n’est pas indifférent de relever que, lorsque Christiane Taubira a déposé le texte qui deviendra la loi qui porte son nom, elle y avait intégré le sujet des réparations, sous la forme d’un article invitant à la création d’un comité chargé « de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime ». Bien que limitée à une réflexion sans obligation juridique, cette approche frontale a disparu au terme de la discussion parlementaire, suscitant les regrets de C. Taubira, qui a néanmoins pu préciser le champ et la portée de sa proposition dans son discours en séance publique : « Cette inscription dans la loi […] constitue une réparation symbolique, la première et sans doute la plus puissante de toutes. Mais elle induit une réparation politique en prenant en considération les fondements inégalitaires des sociétés d’outre-mer liées à l’esclavage, notamment aux indemnisations en faveur des colons qui ont suivi l’abolition. Elle suppose également une réparation morale qui propulse en pleine lumière la chaîne de refus qui a été tissée par ceux qui ont résisté en Afrique, par les marrons qui ont conduit les formes de résistance dans toutes les colonies, par les villageois et les ouvriers français, par le combat politique et l’action des philosophes et des abolitionnistes. Elle suppose que cette réparation conjugue les efforts accomplis pour déraciner le racisme, pour dégager les racines des affrontements ethniques, pour affronter les injustices fabriquées. Elle suppose une réparation culturelle, notamment par la réhabilitation des lieux de mémoire. »
Ayant par ailleurs écarté dans son rapport l’idée d’une indemnisation financière individuelle, C. Taubira pose dans cette intervention un cadre qui reste d’autant plus d’actualité que les problèmes à régler par une telle démarche sont eux-mêmes actuels. En effet, ce n’est pas le passé qu’elle aspire à réparer (comment le pourrait-on ?), mais le présent et ses injustices, ses inégalités, ses discriminations, le concept de « réparation » n’étant ici utilisé que pour montrer les racines historiques de ces maux bien réels à corriger.
S’engager enfin
Pourquoi, alors, cet appel n’a-t-il pas été entendu en 1999, lorsque ce texte a été discuté ? Sans doute parce qu’il demandait un double effort de lucidité, à la fois sur l’horreur du crime (que la loi a su reconnaître) mais aussi sur l’ampleur et la persistance de ses dommages, dont la correction suppose de déranger bien des habitudes, de remettre en cause bien des avantages, d’interroger des préjugés et des situations bien ancrés. 25 ans plus tard, les choses n’ont guère changé, et l’appel de C. Taubira résonne peut-être avec plus d’acuité encore : en Hexagone, où le racisme subsiste et trouve désormais de puissants relais politiques et médiatiques pour se diffuser ; dans les outremers, où la crise de la « vie chère » en Martinique fin 2024 a témoigné des effets délétères d’une économie de comptoir toujours ancrée dans le modèle colonial ; dans nos relations avec le reste du monde, quand le scandale de la somme exorbitante extorquée aux Haïtiens il y a deux siècles pour indemniser les anciens propriétaires esclavagistes de Saint-Domingue revient nous hanter au nom d’une justice historique qui n’est jamais passée.
C’est la raison pour laquelle, 25 ans après le vote de la loi Taubira, je crois que le moment est venu pour la France d’enfin s’engager pleinement dans la démarche réparatrice que ce texte avait esquissée. Notre pays montrerait alors une nouvelle fois le chemin en devenant la première ancienne puissance coloniale à accepter d’ouvrir officiellement le dossier des réparations de l’esclavage. À un moment où le monde a plus que jamais besoin d’unité, de fraternité et de réconciliation, là résiderait la vraie grandeur.