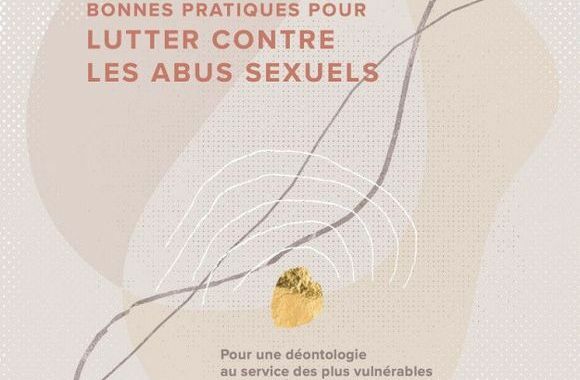Certaines organisations d’Églises sont-elles plus favorables à la gestion des conflits et des abus ?
– Les Églises sont des groupes humains. Toutes sont confrontées au risque d’abus de pouvoir ou de conflit qu’elles tentent de gérer au mieux. Certaines tendent à privilégier l’échelon local comme c’est souvent le cas dans les communautés évangéliques ou baptistes. La structure synodale nationale peut y être inexistante ou relever d’une simple coordination. D’autres, comme l’Église protestante unie de France (EPUdF), ont choisi un régime presbytérien synodal qui recherche l’équilibre entre la vie locale et la vie synodale, pour respecter l’autonomie des paroisses tout en ayant une régulation synodale forte. Entre ces deux modes de fonctionnement, toutes les variantes existent. Mais aucun système n’élimine le conflit ni n’écarte les abus.
Et quand cela se passe mal dans une paroisse ?
– Dans le régime presbytérien synodal, il arrive que des conflits ou abus d’autorité se dévoilent localement. Si les outils locaux sont insuffisants pour pacifier la crise, le niveau consistorial ou régional intervient, notamment par le président du conseil régional ou l’inspecteur ecclésiastique. Mais l’équilibre souhaité donnant une forte autonomie aux paroisses, il existe peu de moyens de régulation autres que la persuasion et l’autorité morale personnelle. Le fait que les pasteurs soient des ministres de l’union des Églises, nommés pour un temps défini, a aussi son importance dans la gestion des crises, même si les sanctions contre le dysfonctionnement d’un pasteur sont extrêmement rares. Le règlement des conflits entre paroissiens ou avec un conseil presbytéral est, quant à lui, peu pris en compte. À tel point que la possibilité pour un conseil régional de provoquer l’élection d’un nouveau conseil presbytéral en cas de déficience grave n’a été votée que récemment dans l’EPUdF.
Dans des milieux plus congrégationalistes comme le pentecôtisme, les abus et conflits se gèrent avant tout au niveau local. Le pasteur fait ainsi fonction de berger, dont le statut est éminent par rapport même à son conseil. C’est donc naturellement par lui que passent les solutions. En revanche, s’il dysfonctionne lui-même, la seule sanction sera la loi de la réalité : hémorragie des fidèles ou rupture d’unité entre ceux qui suivent le berger et les autres.

Les outils sont-ils suffisants pour prévenir les abus ?
– Il y a deux niveaux de réponse. Le premier est local. Les membres des conseils presbytéraux sont de plus en plus formés au monde de l’entreprise et en utilisent parfois les méthodes, notamment en ressources humaines. Les pasteurs eux-mêmes ont le plus souvent vécu une expérience professionnelle antérieure, souvent en entreprise. Cet ensemble donne à la paroisse des outils supplémentaires dans le repérage et la gestion des crises. La médiation pourrait être fort utile également, par sa capacité à prendre en compte des conflits naissants. Plusieurs régions de l’EPUdF ont une équipe dédiée, c’est une manière de faire intervenir des personnes extérieures à l’Église pour décentrer les regards.
Le second niveau de compréhension est plus fondamental. C’est la différence entre autorité et pouvoir. L’Église réformée de France avait commencé un travail sur ce thème en 2002, « Qu’est-ce qui fait autorité dans ma vie ? ». Ce travail serait sans doute à approfondir aujourd’hui, car l’Église me semble souffrir d’un excès d’importance donnée à l’autorité sur le pouvoir. Si l’autorité est bien ce que l’on reconnaît à quelqu’un ou à une décision, alors les décisions synodales ou de conseil presbytéral s’imposent. Or, pour les appliquer, une certaine forme de pouvoir est nécessaire, dont les Églises paraissent se méfier. Plus que les outils, c’est donc la vision du pouvoir et son articulation avec l’autorité qui peuvent être approfondies.