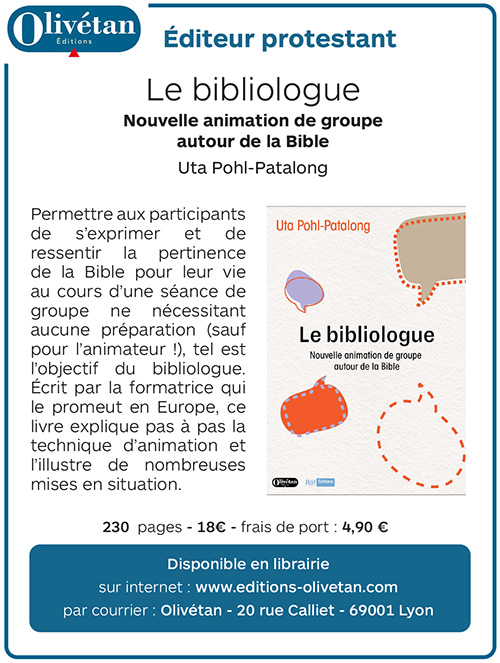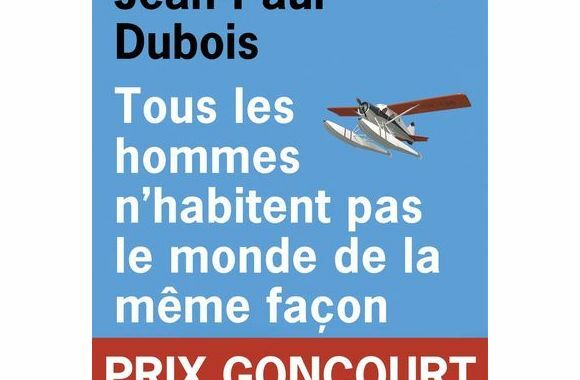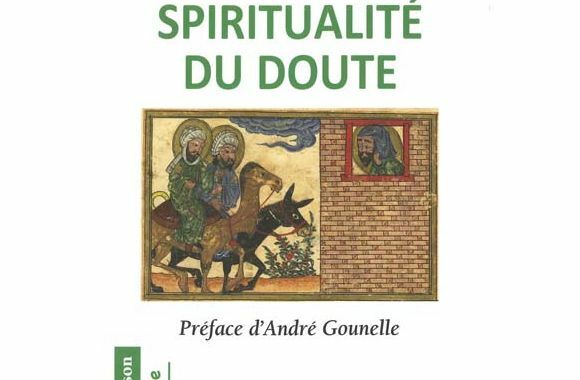Qui n’a pas vécu cette expérience de l’éloignement, à un moment de sa vie ?
La foi n’échappe pas à la traversée du doute. Celui-ci est souvent regardé comme l’adversaire de la foi, ce qui l’ébranle, ce qui la remet en question. Or la foi – en tout cas la foi chrétienne – n’est jamais sans le doute. Ils sont inséparables. Le doute peut être une interrogation critique, ou le vertige de questions sans réponse. Il est parfois un bouleversement où tout chavire, quand nous connaissons de grandes épreuves, la maladie, le deuil. Beaucoup d’entre nous ont connu de tels moments où ce qui soutenait l’existence s’effondre. Le silence de Dieu est une blessure, Dieu ne répond plus, il semble être aux abonnés absents.
Ajoutons que l’Histoire souvent tragique que nous vivons, amplifiée par les médias, paraît un démenti permanent à l’idée d’un Dieu d’amour qui accompagnerait la vie des humains. Nous revient en pleine figure la contestation?: « le Dieu auquel vous croyez n’est-il pas absent de notre Histoire ? »
Le doute est l’envers de la foi, sa face de l’ombre, dites-vous. Comment définir ce doute ?
C’est à la fois une mise en question et une mise à l’épreuve. Le doute peut prendre diverses formes, il y a toute une gradation?: une attitude sceptique proche d’une indifférence religieuse, la mise en cause de formulations traditionnelles, jusqu’à un « doute existentiel », lorsque les fondations sont ébranlées. Dieu est plus de l’ordre des questions que des réponses.
La foi n’est pas une évidence. Elle est une confiance en un Dieu qui nous appelle et nous accueille inconditionnellement, la réponse à une Parole qui nous saisit et nous met en route, un acte de gratitude, d’émerveillement même. Mais cette confiance est mise à rude épreuve par les événements de la vie, les grandes cassures que l’on peut connaître. Le doute n’est pas une défaillance de la foi, il en est l’autre face, la face de la fragilité, du questionnement critique, de l’incertitude. J’aime l’étymologie du mot doute, qui vient de la racine « deux ». Le doute, c’est connaître en soi le débat, être partagé, vivre un questionnement que la foi ne supprime pas. Le contraire, ce serait d’être « entier », sans rien qui permette du jeu, de la distance, ce qui est le propre du dogmatisme, ou de l’intolérance. Comme le dit joliment Jean d’Ormesson dans son livre C’est une chose étrange à la fin que le monde?: « Je doute de Dieu parce que j’y crois. Je crois en Dieu parce que j’en doute. Disons que je doute en Dieu ». On ne sait pas toujours si c’est la foi qui domine ou le doute qui l’emporte. Croire, c’est toujours croire malgré?: nous croyons en dépit du vide et du silence, en dépit du mal et de la mort.

Le silence de Dieu a-t-il à voir avec notre représentation de Dieu ?
Oui. Le Dieu de la Bible est un Dieu dont le mystère nous échappe. Il y a toujours cette dimension d’obscurité?: un Dieu « caché », qui le demeure jusque dans l’acte par lequel il se révèle. Nous rêvons parfois d’une relation transparente où Dieu s’imposerait à nous comme une évidence indiscutable. Il nous faut renoncer à ce rêve. Certes, il y a dans la vie des moments où tout est lumineux, mais ce ne sont que des moments, des moments de grâce. Heureux les croyants qui connaissent de tels moments. Je suis frappé de voir combien dans les Psaumes l’expérience du silence de Dieu est présente. Or les Psaumes sont le cœur battant de la foi d’Israël, et de l’Église. Et l’appel?: « pourquoi dors-tu ? Sors de ton silence ! réveille-toi », jusqu’au cri?: « pourquoi m’as-tu abandonné ? »
C’est ainsi que du plus profond silence la Parole peut surgir. Nous ne connaissons cette Parole que si nous connaissons aussi ce silence. La foi est un cheminement qui se construit dans une relation vivante avec Dieu, à travers ombres et lumières. Cette relation passe par des moments de désarroi, de crise, où notre perception de Dieu est remise en question, où elle sera modifiée peut-être. Qui n’a pas connu ces déserts de silence ne connaîtra pas vraiment ce qu’est l’événement de la Parole.
Peut-on trouver une signification à ce silence de Dieu ?
Dans les écrits bibliques il n’y a pas un, mais des silences de Dieu, qui n’ont pas la même portée. Ce silence est souvent lié à la souffrance ou au tragique de la vie, et l’on pense à Job criant vers Dieu du plus profond de l’épreuve. Mais d’autres textes ont d’autres résonances. Pensons au Cantique des cantiques, l’un des plus beaux chants d’amour de la littérature universelle?: Dieu n’y est jamais nommé. Son silence est là comme un sol qui nous porte, une secrète approbation à la vie humaine.
Le silence peut être l’intervalle entre la parole reçue et la parole espérée?: un temps d’attente. Mais il provoque souvent le sentiment d’une absence, d’un éloignement?: la perte du Dieu en qui l’on avait cru. Quand on est fracassé par l’épreuve, comment croire encore en un Dieu qui nous aime ? La foi prend aussi le visage de la révolte, d’une protestation contre l’inacceptable. Quand ce qui soutenait la vie s’effondre, c’est l’absence de Dieu qui est ressentie, parfois même son rejet.
Pensez au récit d’Emmaüs. Deux disciples marchent sur la route. Ils étaient partis à la suite de Jésus, pleins d’espoir en lui. Et tout s’est effondré avec sa mort. Un inconnu les rejoint en chemin. Et commence ce dialogue en marchant, jusqu’à l’instant où le Christ leur apparaît, mais pour disparaître aussitôt. C’est par-delà la perte qu’ils ont découvert le Vivant. Il a fallu qu’ils le perdent pour qu’ils en viennent à le redécouvrir. Ainsi nous faut-il parfois perdre la confiance première, native, pour retrouver – par-delà la perte – la présence du Christ.
Comment transmettre une parole d’espérance à quelqu’un qui ressent le vide de l’absence ?
D’abord écouter. Partager. Cheminer avec. La parole naît de la rencontre, de manière inattendue. C’est par le manque que nous portons en nous que nous communiquons avec l’autre. Le doute est une faille dans la foi, qui préserve ce manque. Il nous ébranle, c’est vrai, mais il nous fait évoluer. Il favorise la remise en chantier de nos convictions. Notre perception de Dieu change?: il n’est plus dans la toute-puissance souveraine, mais dans l’abaissement, dans une certaine manière d’accompagner notre quotidien, qui nous fait sentir jusqu’au plus bas des profondeurs que nous ne sommes pas seuls à vivre. Dans le récit d’Emmaüs, c’est après-coup qu’ils le découvrent?: il était là, et nous ne le savions pas. C’est après-coup que le passé s’éclaire et prend sens. Promesse pour nous aussi, sur tous nos chemins. Incognito, il vient. La grâce, c’est toujours l’imprévisible.