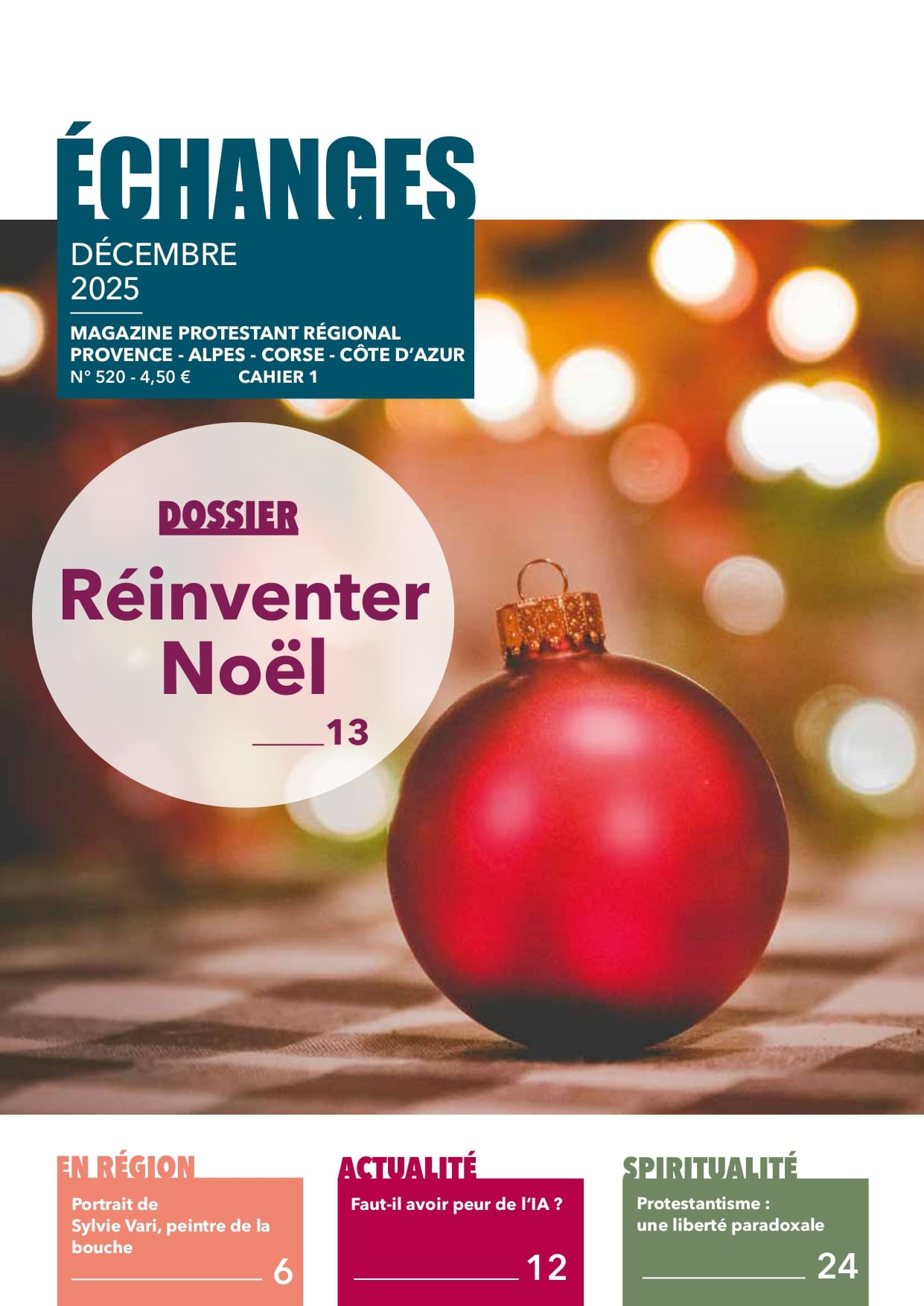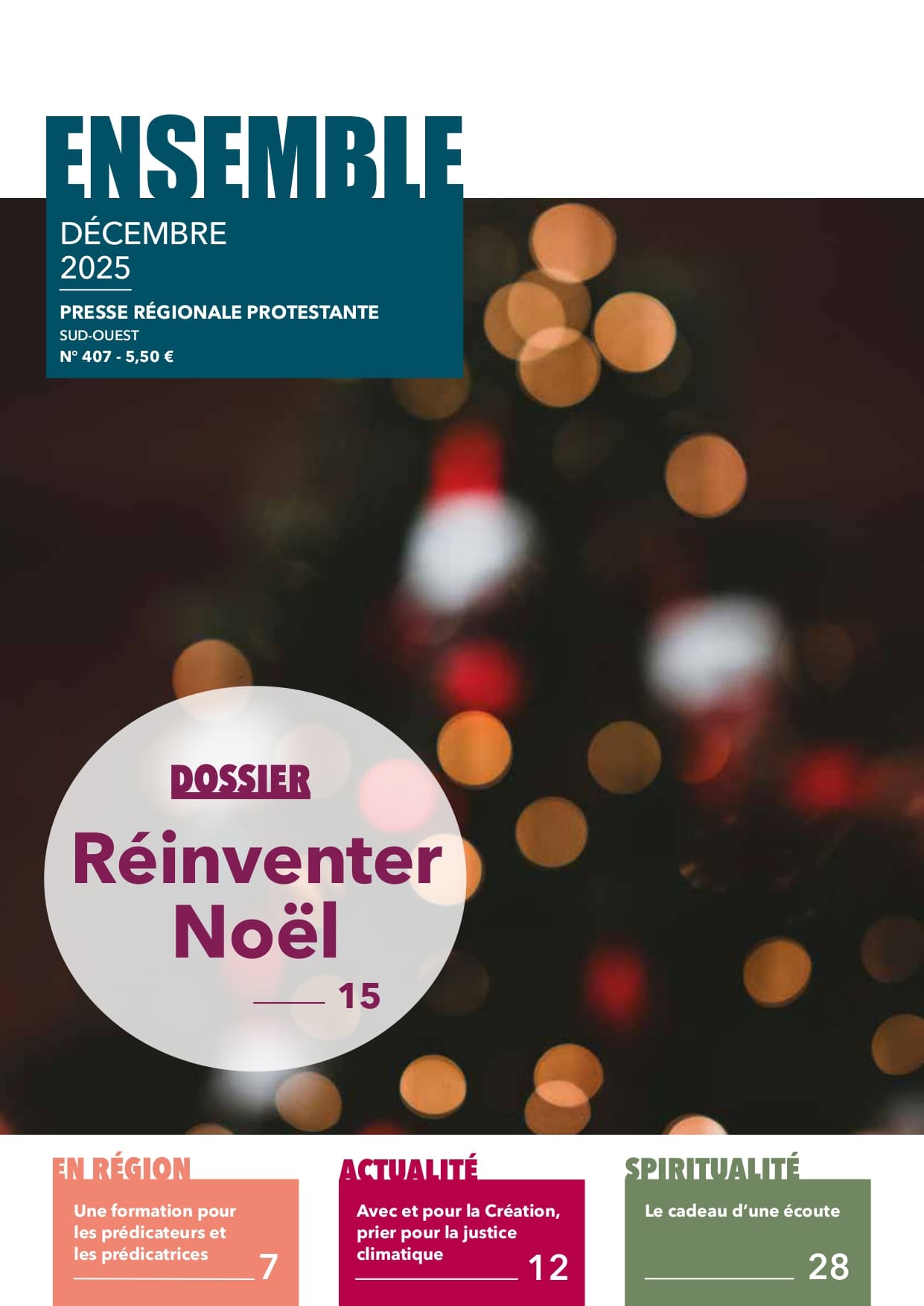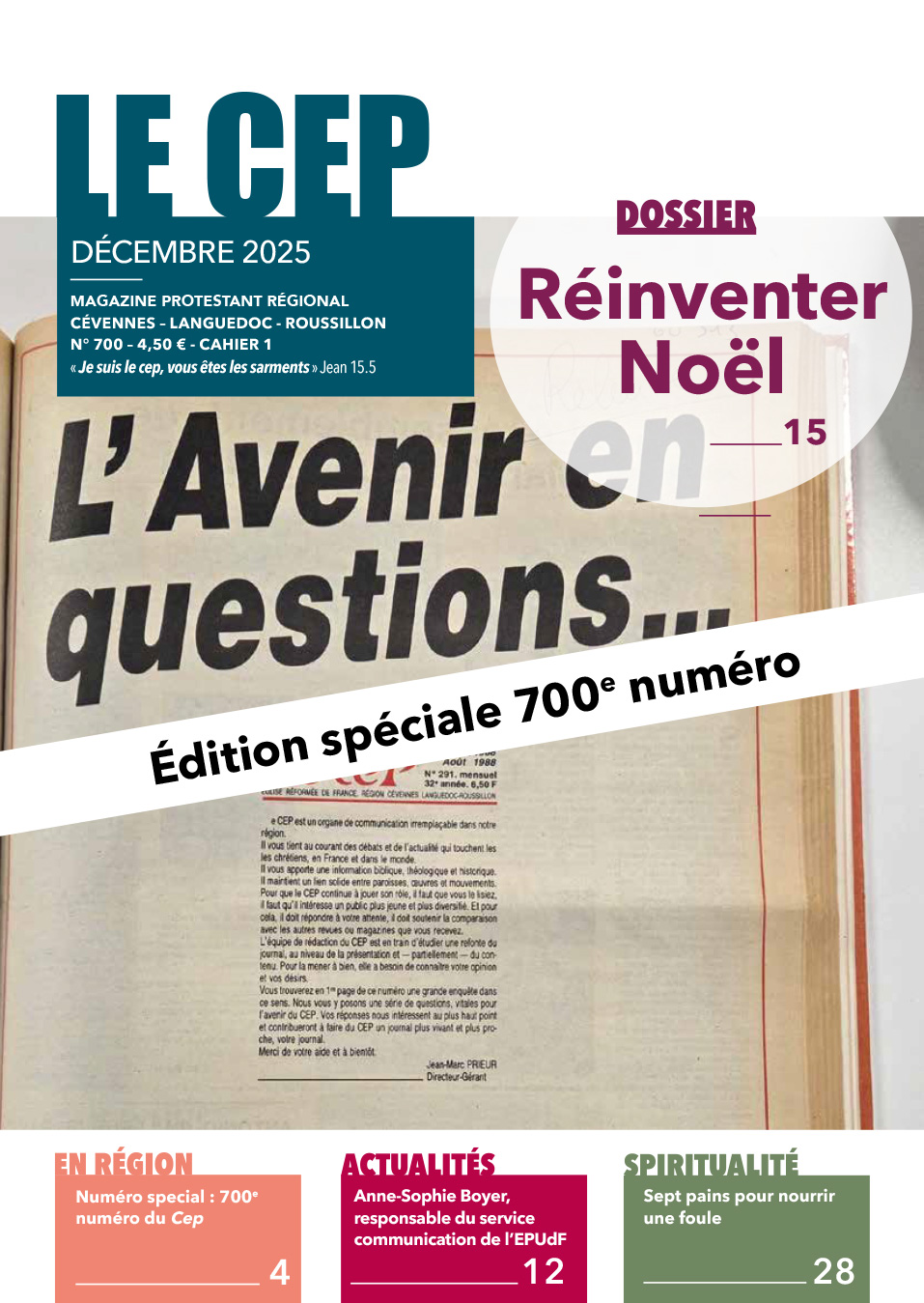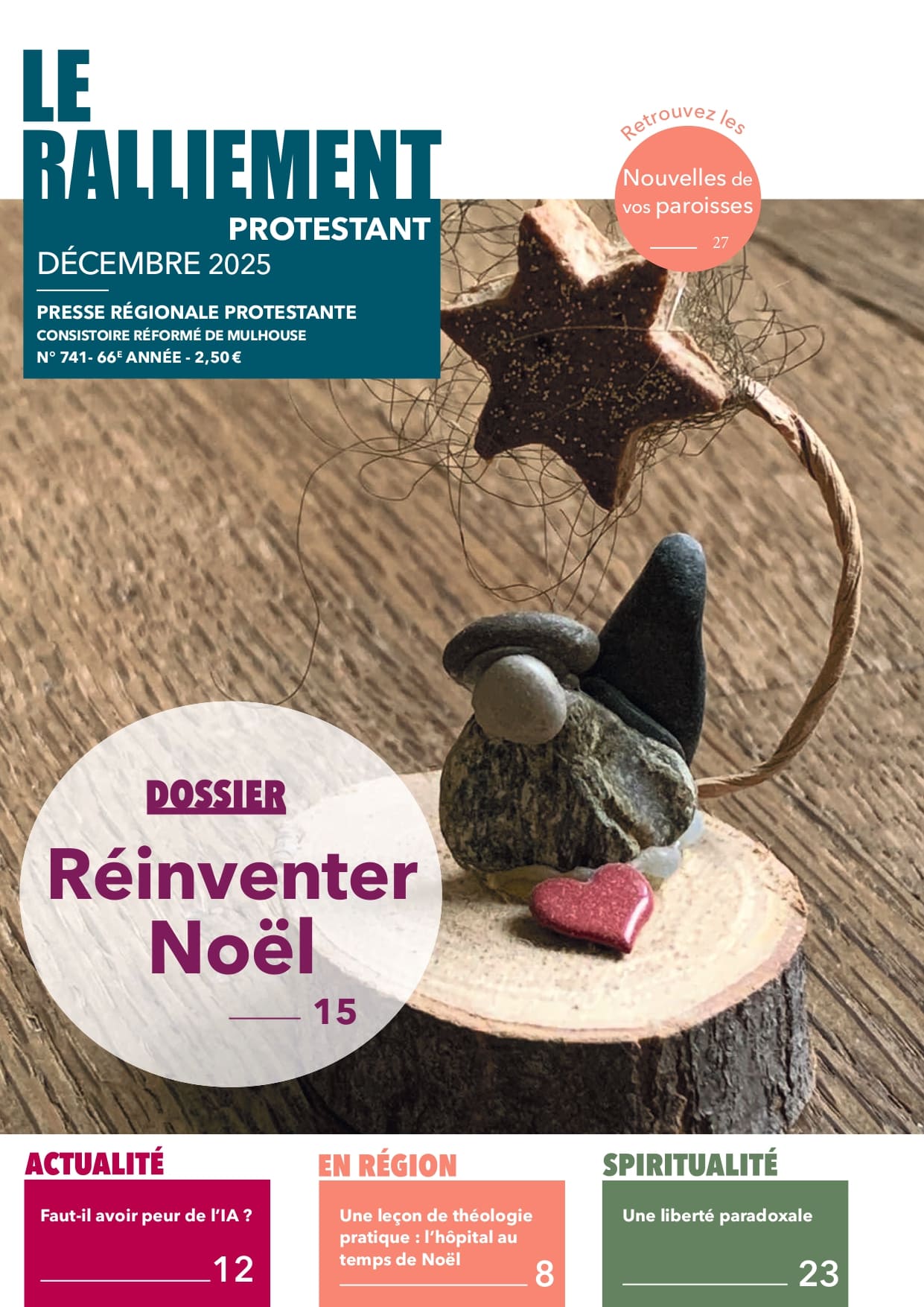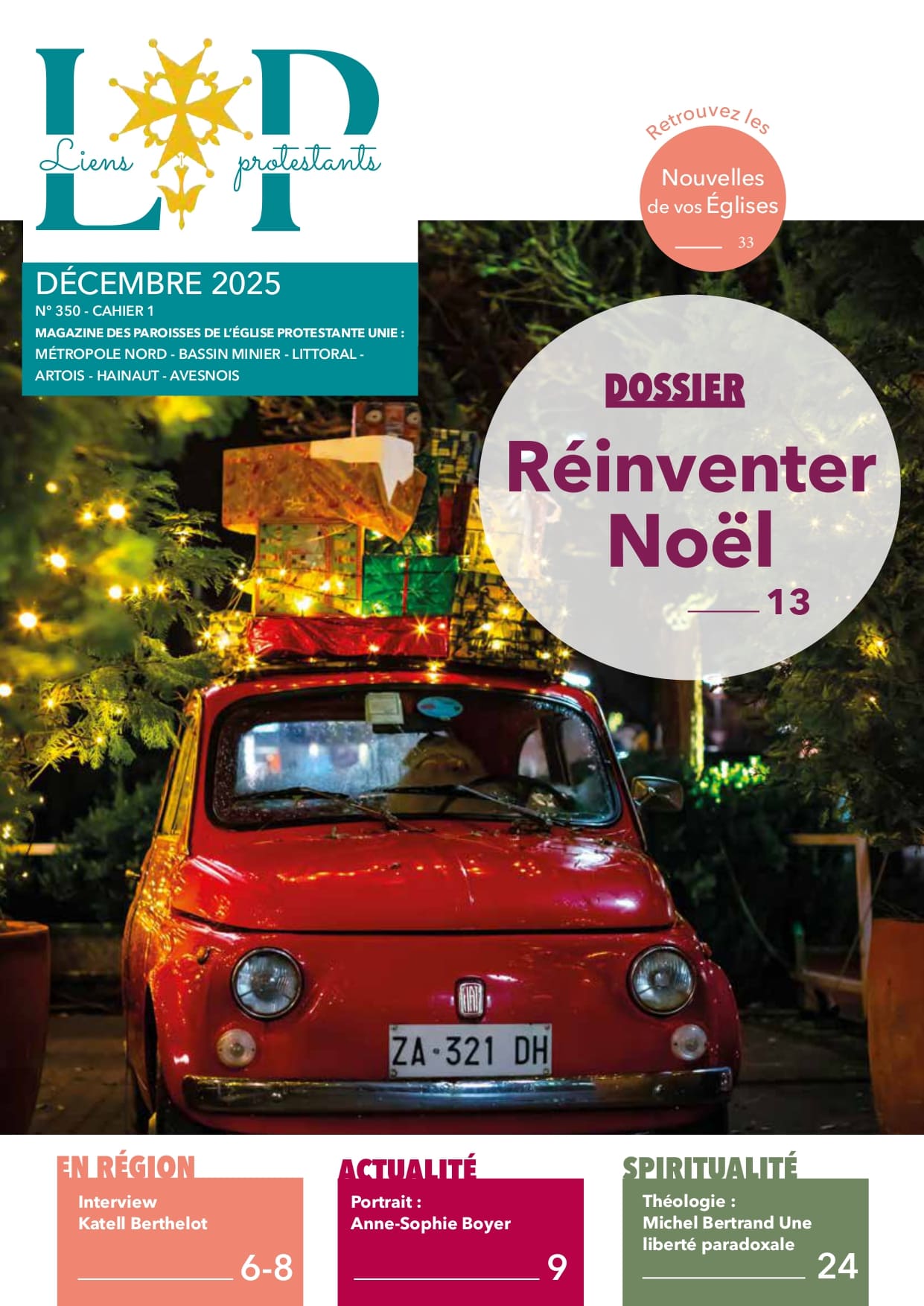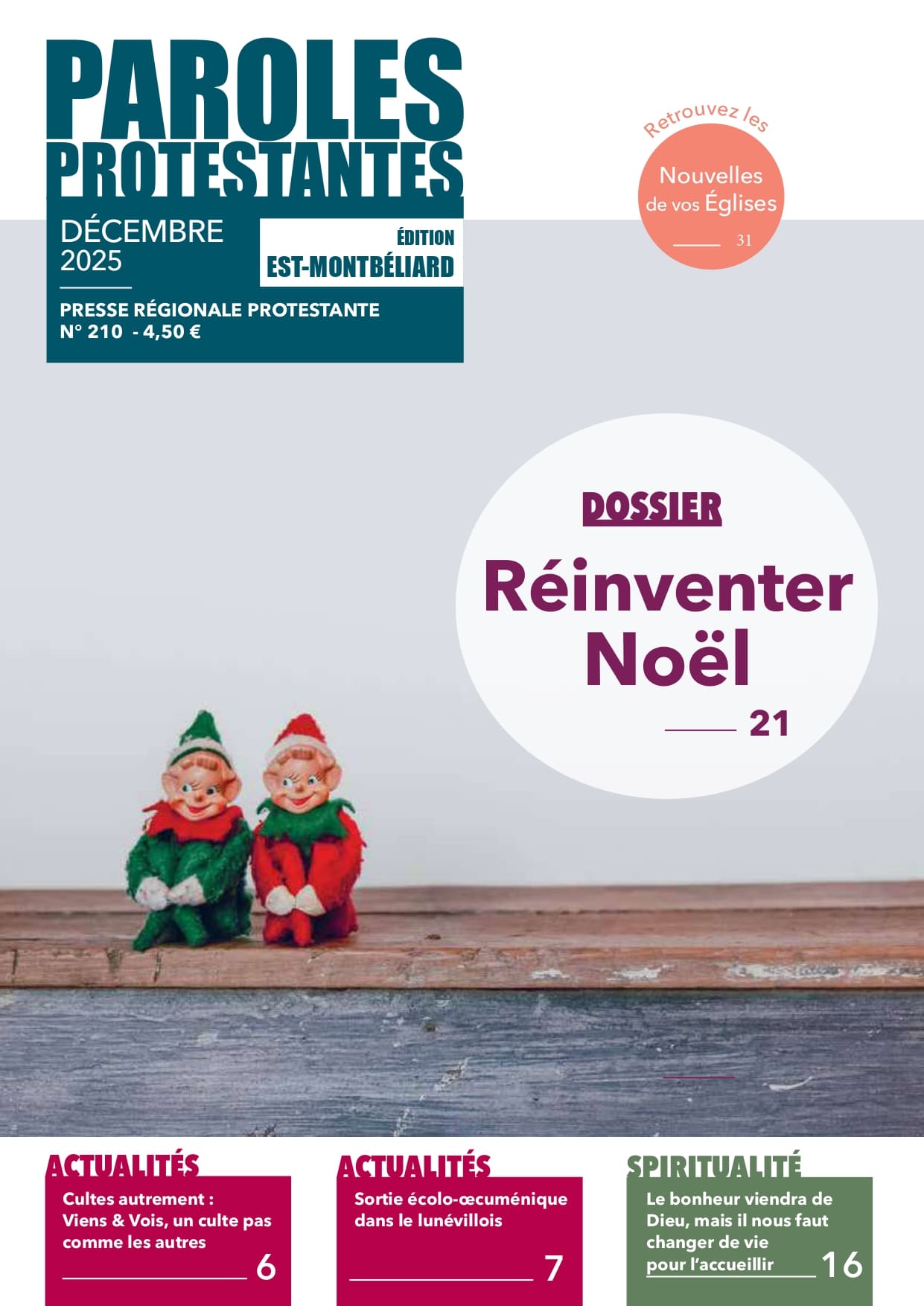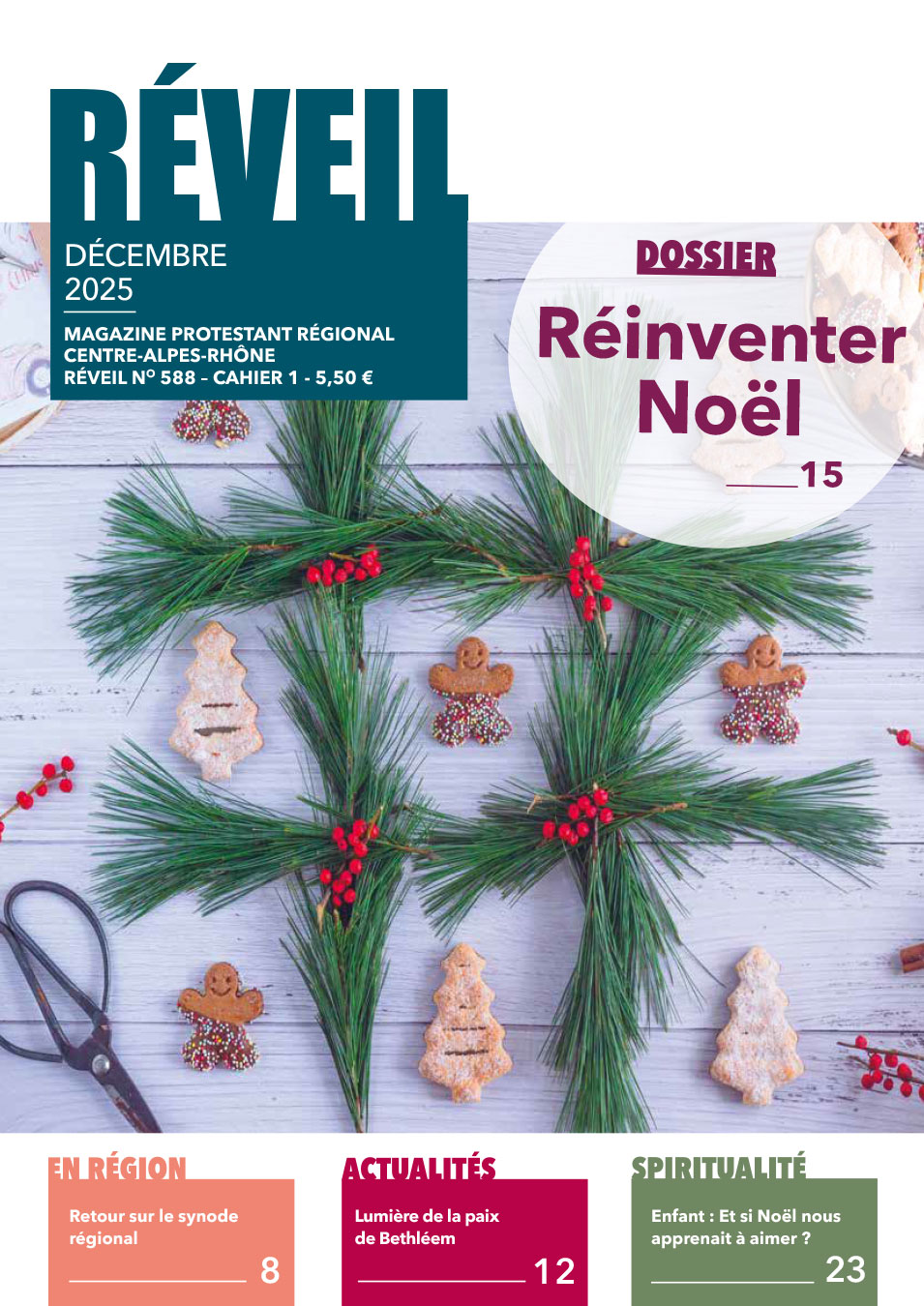Mange-t-on toujours assis à table à l’aide d’un couteau et d’une fourchette ?
Évidemment non ! Il existe bien des manières de prendre les repas.
Dans le monde romain, on se couche à table pour manger à demi allongé sur un triclinium qui accueille trois convives. Dans d’autres lieux, d’autres temps ou d’autres occasions, on mange « sur ses genoux », debout, accroupi·e en se servant dans un plat à même le sol ou agenouillé·e devant une table basse.
On peut manger avec des couverts, des baguettes ou simplement avec ses doigts. En Occident, on utilise longtemps le seul couteau pour découper les aliments et les porter à la bouche. La Venise byzantine ajoute la fourchette dès le 11e siècle. L’assiette arrive en France avec François 1er ; elle finit par remplacer les écuelles en bois et les « tranchoirs » de pain sec que l’on peut consommer à la fin du repas. Tous les ustensiles, les couteaux comme les tranchoirs et même les serviettes de table sont longtemps partagés par plusieurs convives.

(© Denis Marchand)
Depuis quand choisit-on ce que l’on mange ?
On a l’habitude de manger les mets successivement et dans l’ordre imposé par qui prévoit, prépare et sert le repas ; mais dans d’autres époques, sous d’autres latitudes ou dans certaines occasions, on pose tous les plats sur la table, laissant aux convives la liberté et la responsabilité de choisir que manger et l’ordre dans lequel le faire. En fait, ce n’est qu’au début du 19e siècle que la France découvre chez l’ambassadeur de Russie l’usage de servir les plats les uns après les autres ; ce service à la russe permet que les convives mangent chauds les plats chauds et froids les plats froids.
Dans la restauration collective, plus rarement à la maison, on sert les mets sur une assiette individuelle plutôt que dans un plat commun ; certes, on limite encore la liberté des convives, mais on pacifie les relations autour de la table en imposant la répartition des aliments.
Pourquoi se demande-t-on : « Qu’est-ce qu’on mange ? » ?
Dans de trop nombreux temps, de trop nombreux pays et de trop nombreux foyers, la question « qu’est-ce qu’on mange ? » ne porte pas sur le menu, mais sur l’existence même d’un repas.
Mais on a parfois, voire souvent l’embarras du choix. L’amélioration des moyens de transport, les innovations dans l’agriculture et les techniques de conservation élargissent et mondialisent l’offre alimentaire. Refroidissement, fermentation, fumage, séchage et salaison ont toujours permis de conserver et de transporter des nourritures. Mais en 1810, le cuisinier, confiseur et inventeur français Nicolas Appert lance une révolution durable quand il découvre que chauffer des aliments dans un contenant hermétique augmente leur durée de vie. Le 20e siècle fournit encore de nouvelles possibilités, notamment par la mécanisation de la production de froid. Aujourd’hui, on peut manger de tout, partout, et tout le temps, mais au détriment de notre écosystème.
Jusqu’à quand mangera-t-on assis, ensemble, successivement et avec des couverts ?
Dans quelle direction les pratiques autour des repas sont-elles en train d’évoluer ? Je repère quatre tendances sans les juger ni en bien ni en mal.
– On mange de plus en plus debout et en marchant ; corollaire, on achète des mets tout prêts que l’on mange avec ses doigts ;
– Quand les rythmes de vie sont de moins en moins synchronisés, manger en famille devient de plus en plus rare ; on mange seul·e, on mange si on en a envie et quand on en a envie ; on mange aussi ensemble, mais dans d’autres commensalités, scolaires, amicales ou professionnelles ;
– Quand on mange ensemble, on mange des plats différents, chacun·e selon ses envies ; le micro-ondes avait offert la possibilité de réchauffer son propre plat, la livraison à domicile permet de choisir des menus totalement individualisés ;
– La salle et la table à manger deviennent inutiles et tendent à disparaître ; parfois symboliquement – elles existent, mais elles reçoivent une autre fonction – parfois réellement quand les « pièces à vivre » remplacent les « salons-salle à manger », quand les canapés, les fauteuils et la table basse remplacent les chaises et la table à manger.