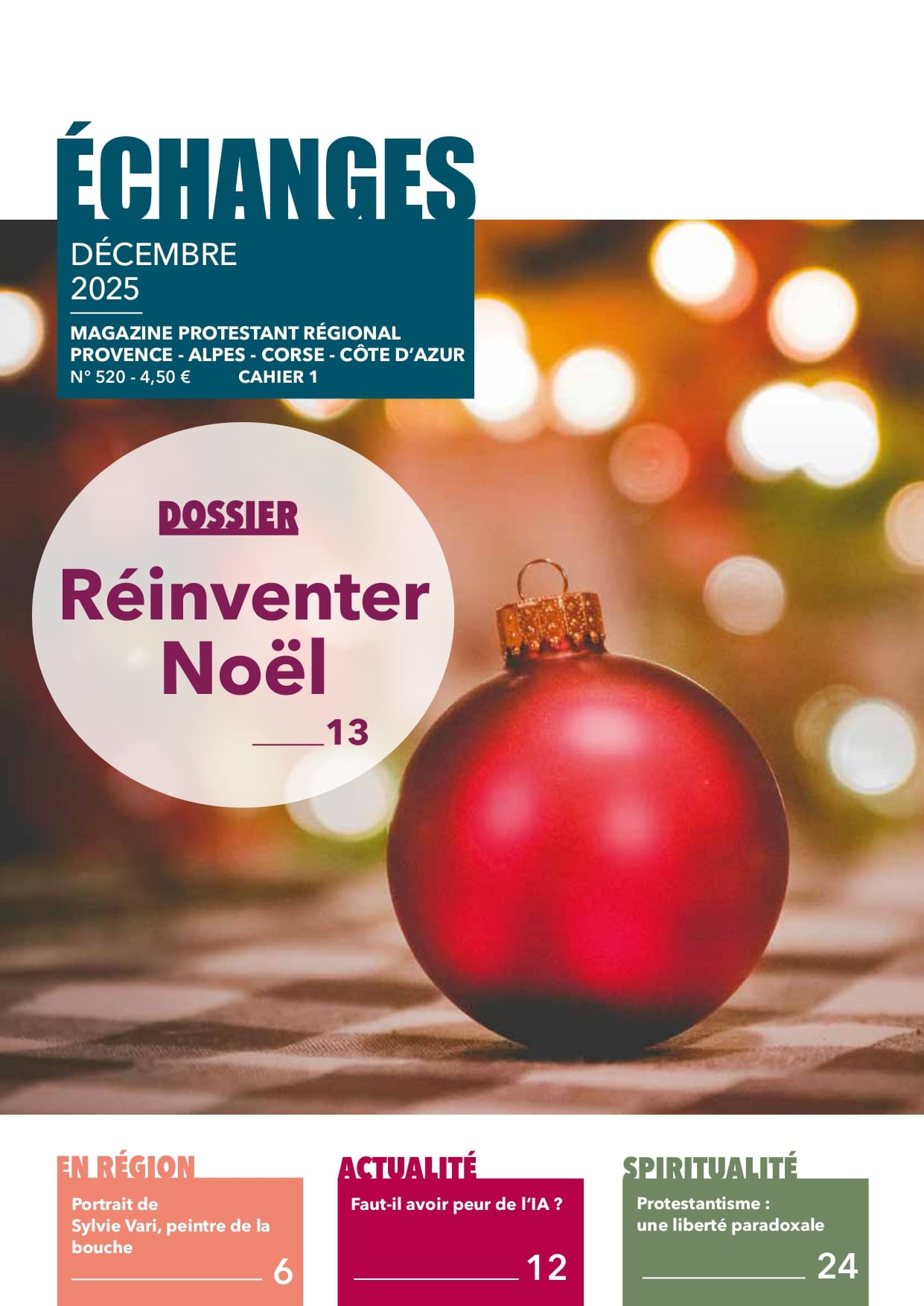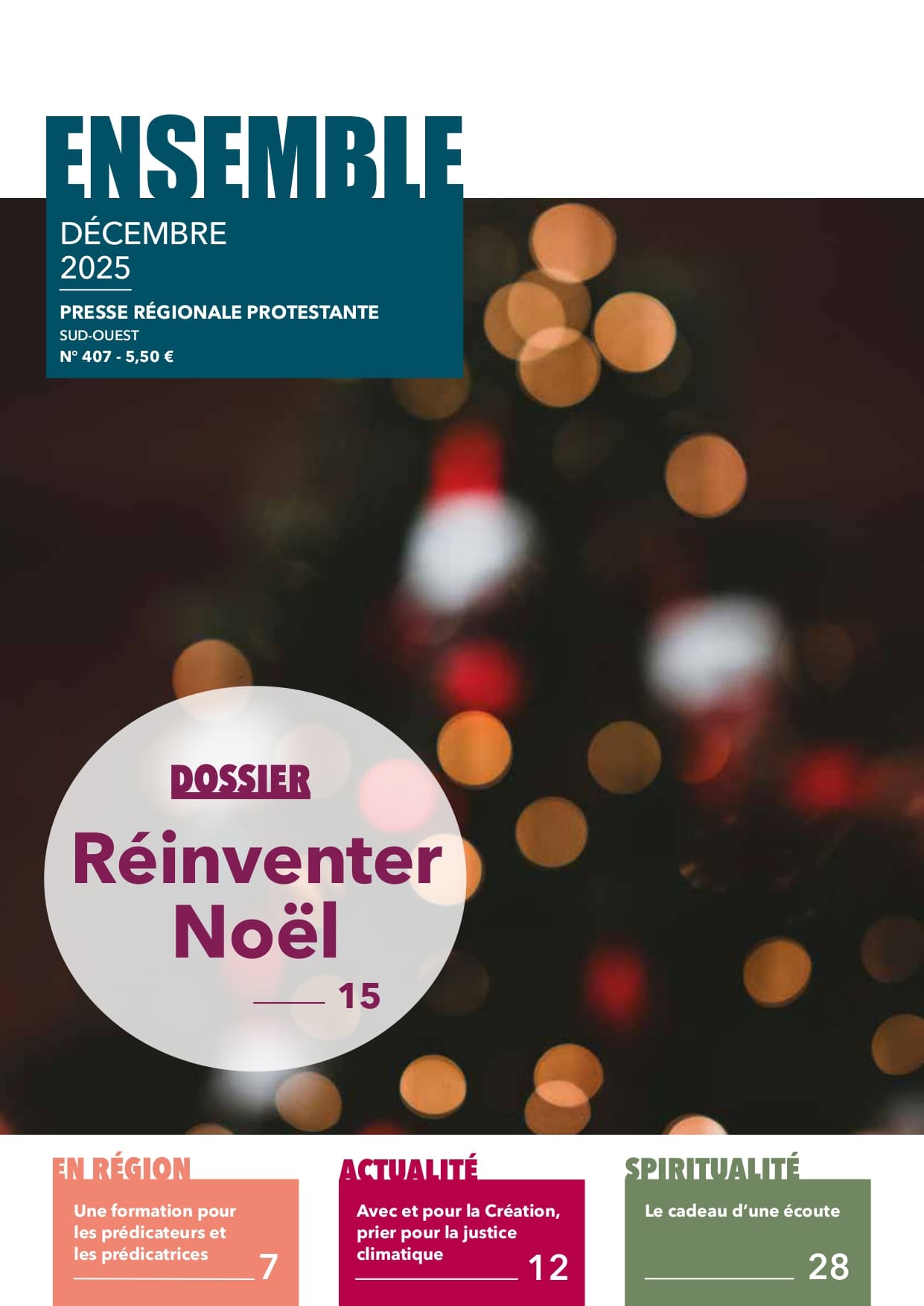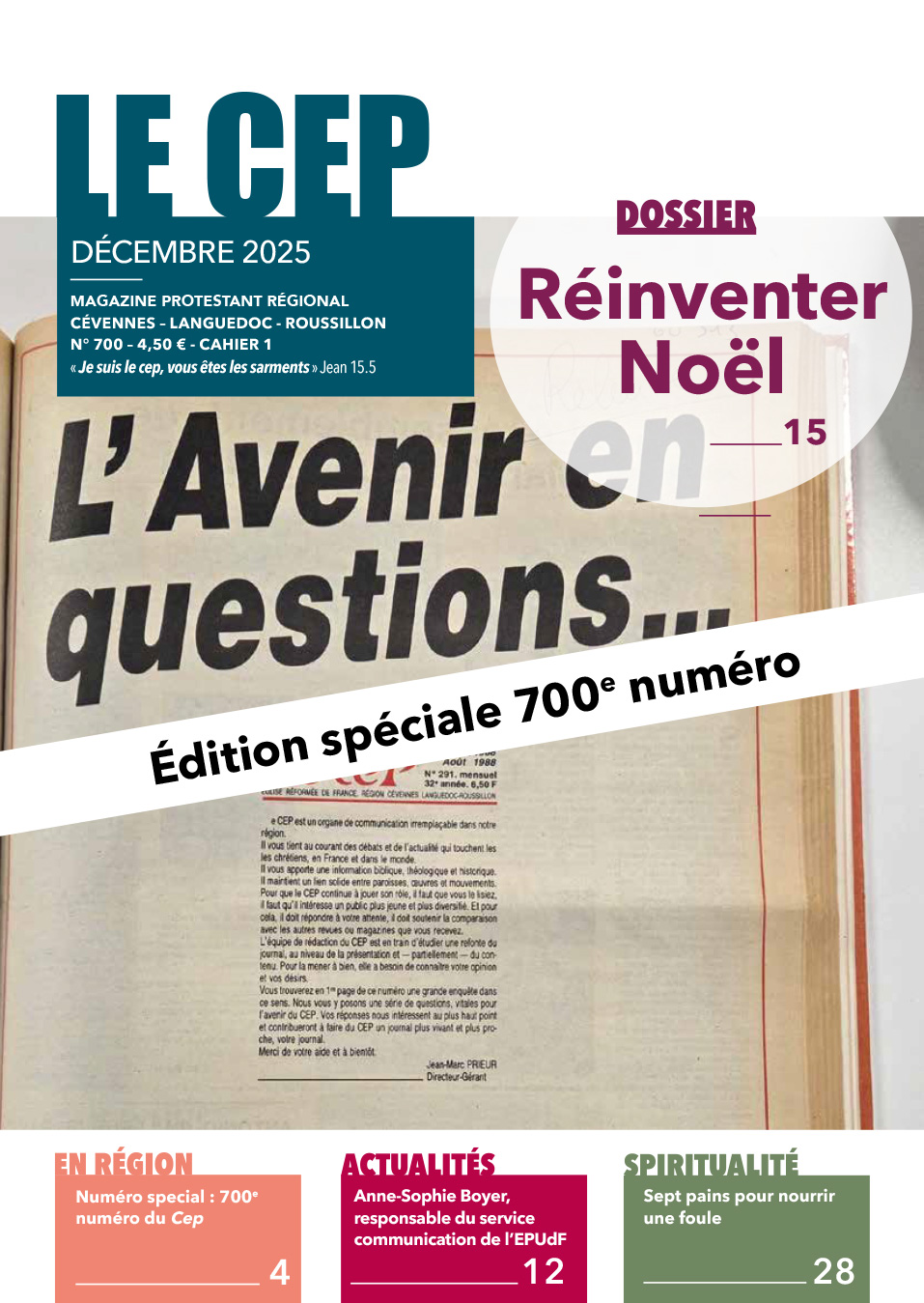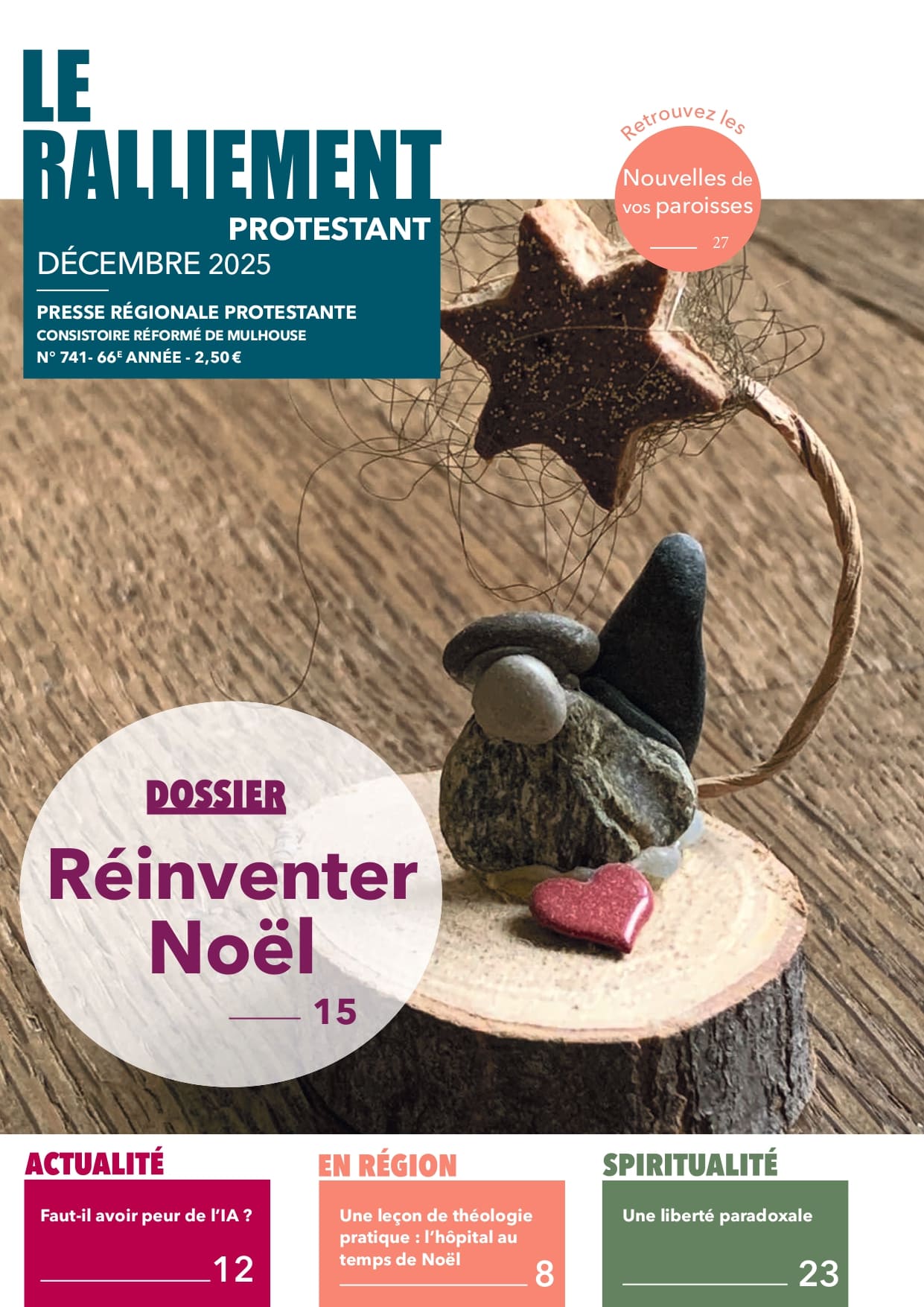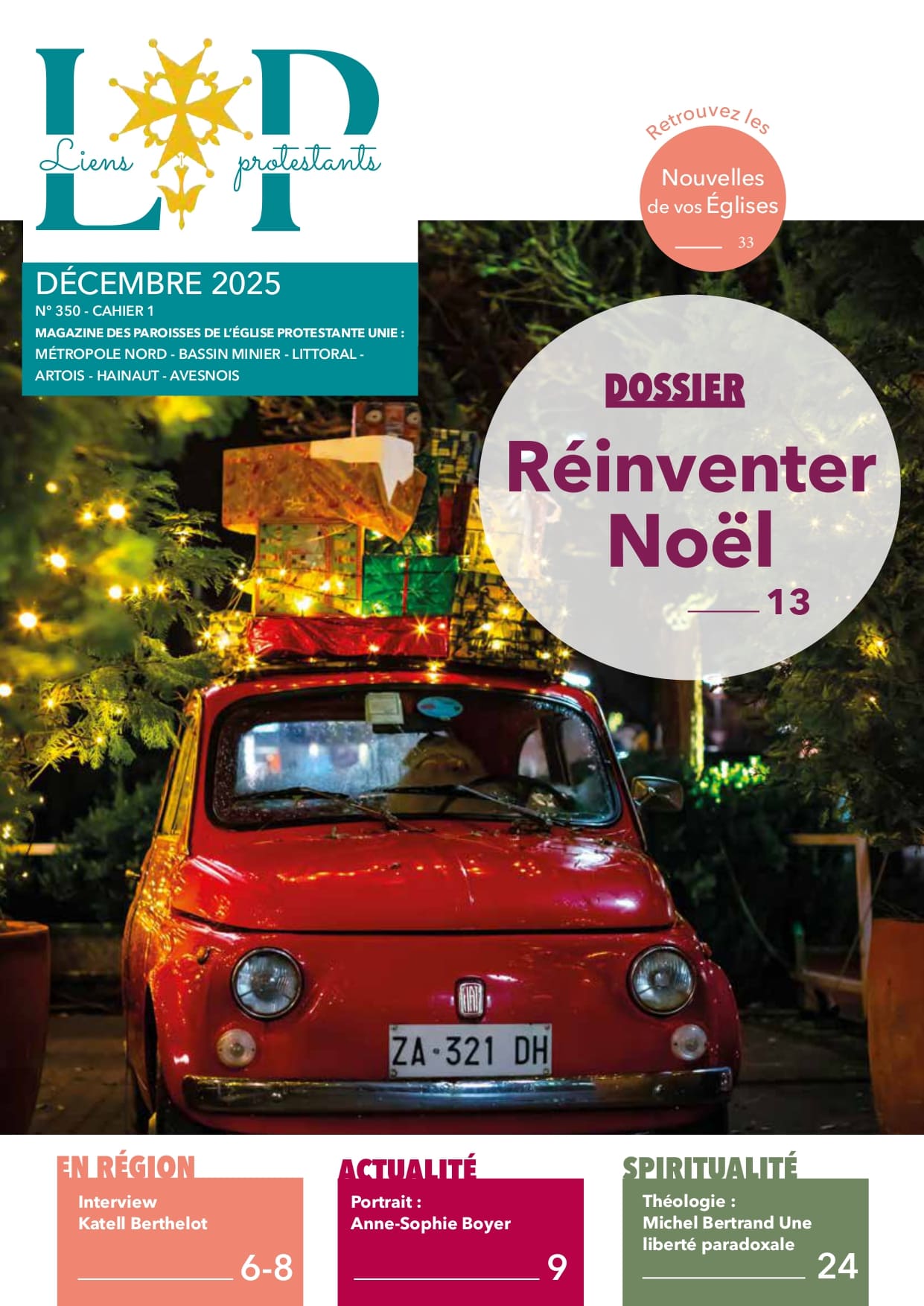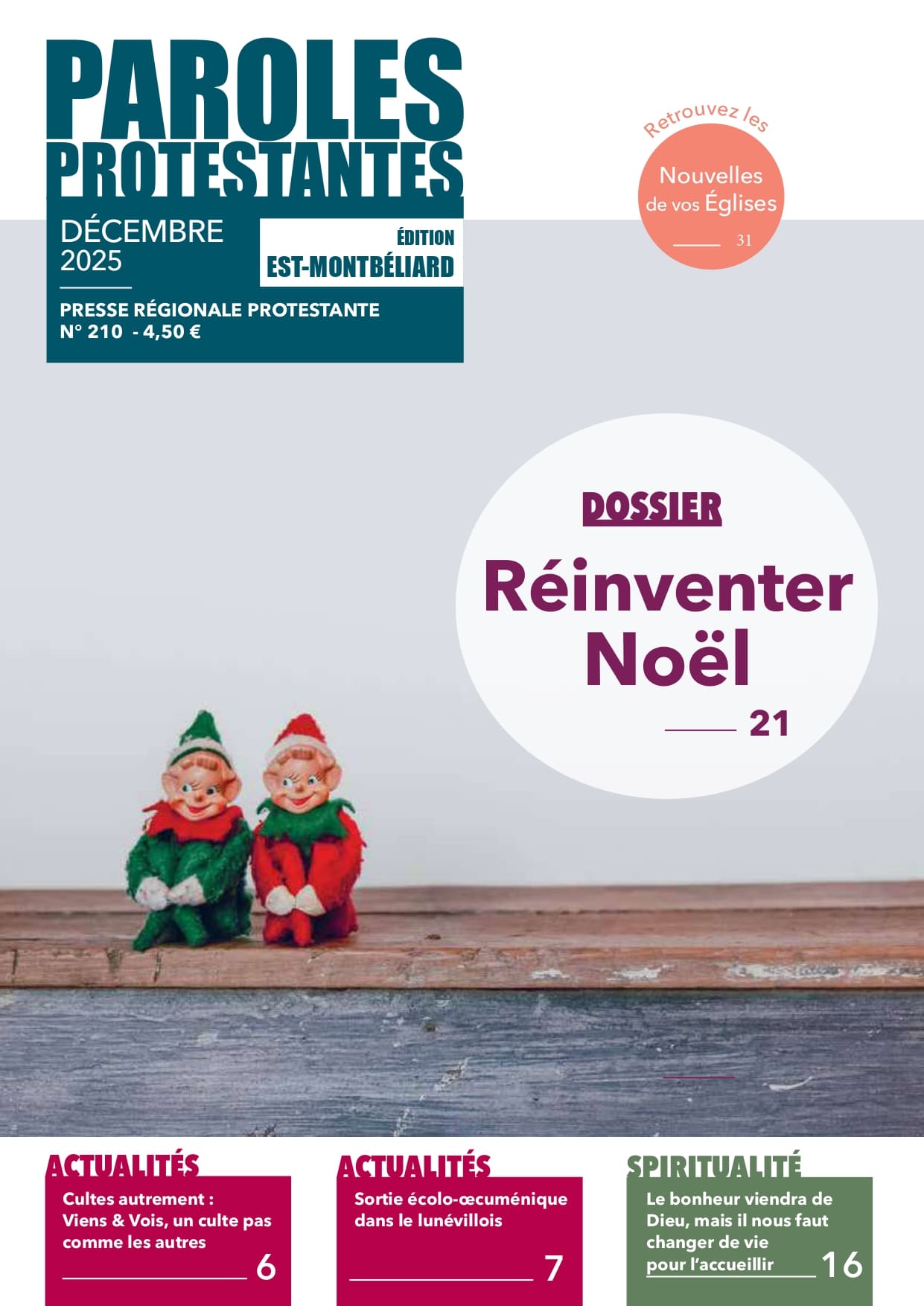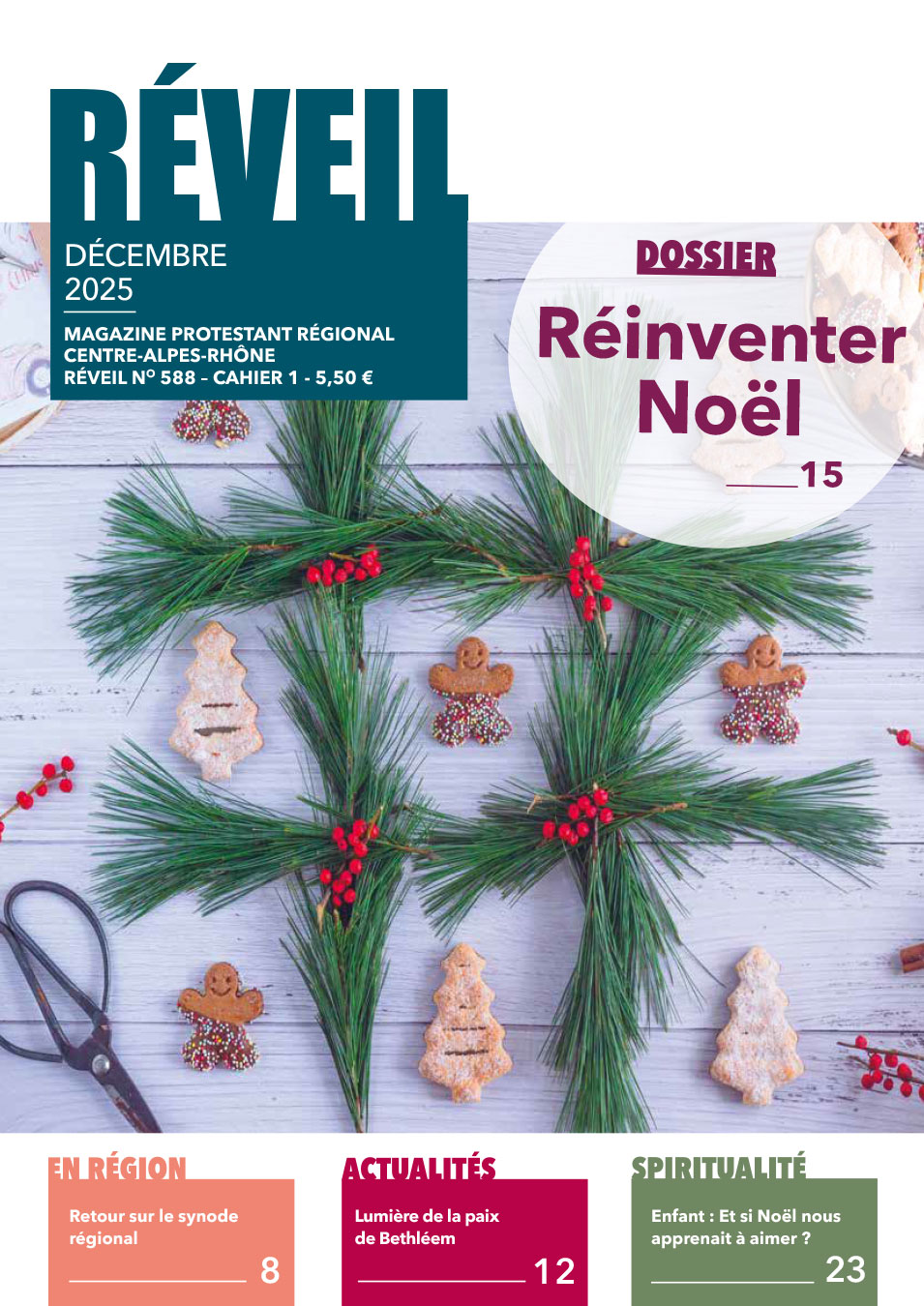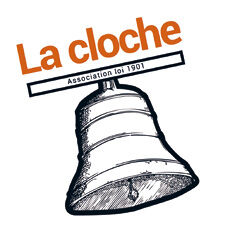| Pour
La pauvreté, c’est d’abord la pauvreté matérielle. Si elle a reculé dans le monde, elle stagne autour de 14 % en France, où on trouve des travailleurs pauvres. Or, tout laisse à penser que la concurrence de la robotisation et de l’intelligence artificielle dans la production et les services va diminuer le nombre de postes de travail, d’abord ceux de faible ou moyenne qualification…
La pauvreté, c’est aussi une vie sans espoir et sans dignité. Et demain, quelle dignité si la concurrence conduit à créer de plus en plus de travailleurs pauvres dans une société où les écarts de revenus ne feront qu’augmenter ? Comment ne pas laisser au bord de la route beaucoup d’entre nous ?
Or, les ruptures en cours sont sans commune mesure avec les ruptures du passé parce qu’elles touchent à tous les aspects de la vie, dans une période où la finitude spatiale, les déséquilibres biologiques et climatiques limitent un développement tous azimuts.
Une réponse possible ? Le Revenu universel de subsistance ; « distribution à tous, par l’État, d’un revenu suffisant pour vivre », avec beaucoup de variantes sur tous, suffisant pour vivre, sur le montant égal ou non pour tous !
Décrire les avantages ou inconvénients de ce dispositif est délicat : on trouve tout et autre chose dans la littérature ! Et des expérimentations (Finlande, Italie…) n’en sont qu’à leur début. Continuons ! Et, rêvons un peu : c’est l’utilité sociale de l’activité qui assure la reconnaissance sociale et non plus l’emploi ; les écarts de revenus diminuent…
Pour terminer, mes espérances inusables : « Toute personne […] est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux, culturels indispensables à sa dignité… » (Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 22), mais aussi : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Marc 12.31) et « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse. » (Luc 6.31)
Denis Costil
engagé au Foyer protestant de la Duchère (Lyon)
|
|
Contre
Lors des campagnes pour les dernières présidentielles, j’ai partagé combien j’étais hostile à la proposition de Benoit Hamon d’instituer le revenu universel.
Bien sûr, je n’ai rien d’une férue en économie et ma réaction était une réaction sociale, psychologique et ancrée dans ma foi.
Ce que je reproche à cette proposition de revenu universel, c’est la négation du besoin de tout être humain de travailler et non d’être assisté. Je ne nie pas la nécessité d’aider les démunis, mais pour moi la solution doit être positive. J’ai, chevillée au corps (et à l’esprit), la notion d’espérance et c’est pour cela que je veux espérer qu’il y aura encore du travail pour tous demain et après-demain. Je pense qu’il faut agir pour créer du travail. Mettre en place le revenu universel, c’est être défaitiste, sans espoir, sans croire que l’homme réussira à faire face. Je suis certes optimiste, c’est dans ma nature, mais il faut penser positivement.
Travailler, c’est être intégré socialement, c’est pouvoir dire « je travaille à… », c’est rencontrer d’autres hommes ou femmes, échanger idées et projets. On me répond que cela sera toujours possible grâce au bénévolat. Pour avoir pratiqué le bénévolat sous plusieurs formes et à tous âges, je pense qu’il ne remplacera jamais l’insertion que permet le travail.
Avec le revenu universel, aller travailler sera-t-il encore possible ? Qui fera l’effort de créer du travail ? Va-t-on baisser les bras face à une économie qui pense plus au profit de quelques-uns plutôt qu’au bien de beaucoup ? Certes, je suis à contre-courant.
Aussi, je situe là mon espérance : espérance en l’homme et sa créativité ; en la société et sa responsabilité. Oui, je suis utopiste, mais cela vient de ma foi.
Françoise Costil
bénévole à Emmaüs Lyon
|