Autrefois, on associait « communauté » à une vie monacale. Or aujourd’hui, avec l’influence des réseaux sociaux et les fameux like, ce mot a évolué ; on peut identifier la communauté de ceux qui aiment ceci, la communauté de ceux qui soutiennent cela… Une communauté rassemble un ensemble de personnes qui ont une chose en commun, qu’elles soient géographiquement, sociologiquement… proches ou éloignées.
Pour les communautés priantes, c’est la même chose ; elles dépassent aujourd’hui largement des lieux bien identifiés. Vous avez les « communautés priantes » (sœurs de Reuilly, de Pomeyrol…) et des groupes ou « réseaux » de prière identifiés (Fraternité spirituelle des Veilleurs…) pour lesquels on parle de monachisme intériorisé. Il ne faut pas oublier les Églises locales, car la liturgie dominicale comprend différentes prières, et bon nombre d’Églises ont des « groupes de prière ». Il semble aujourd’hui injustifié d’opposer la manière de prier ici ou là, mais on constate avec joie que la vie priante est toujours un idéal chrétien.
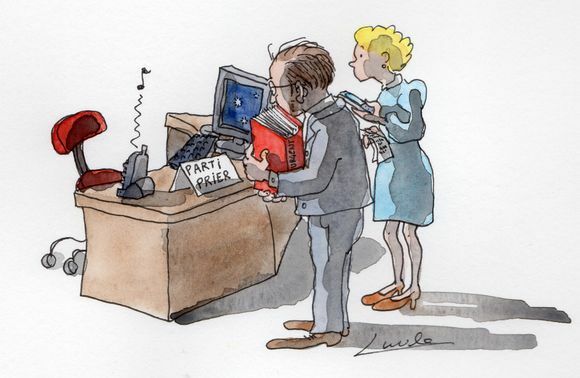
Recherche de spiritualité
L’être moderne vit dans un monde très peuplé et agité, où se conjuguent vitesse et performance. Il découle de ce milieu de vie un besoin de prendre du recul, pour se retrouver, faire silence, approfondir sa relation à Dieu, lire, prier… ou simplement cultiver un jardin.
La méthode douce consiste à organiser sa vie quotidienne à partir de ce constat, en aménageant chez soi un coin de prière et/ou en rejoignant une fraternité de prière, dont l’unité se concrétise par l’usage de la liturgie ou de la règle.
La méthode plus radicale consiste à se retirer un temps du monde, en faisant une retraite.
La réforme a remis la lecture des Écritures au premier plan ; geste nécessaire qui a parfois relégué au second plan la vie intérieure avec la prière. Or l’une et l’autre sont intimement liées ; ne prie-t-on pas avant de lire la Bible, afin que l’Esprit nous inspire ? Notre vie n’est-elle pas appelée à être priante ?
Dans les différentes communautés, la prière est centrale. La journée est habitée par la prière et ponctuée par des moments de prière collectifs (trois ou quatre), du lever au coucher. Soeur Marthe-Élisabeth, prieure de Pomeyrol, dit que sa vie de prière porte son travail. Elle pense que la prière ne transforme pas l’être mais le tourne vers Dieu. La prieure des Veilleurs, la pasteure Claude Caux-Berthoud, dit de la prière qu’elle est un mouvement vers Dieu, un roc qui permet de tenir debout. Chaque Veilleur est appelé à être un petit reflet pour rappeler que Jésus est la Lumière du monde. La prière inspire toute la journée. Claude souligne aussi que Jésus partait rencontrer Dieu dans la prière avant les moments importants de sa vie. Alors, pourquoi pas chaque chrétien ? Enfin, la prière permet à chacun et chacune de se laisser habiter par l’Esprit de Dieu. Sœur Anne, diaconesse à Versailles, souligne que la prière n’est pas uniquement à déléguer à des « pros », car chaque chrétien est appelé à rencontrer Dieu dans la prière. Même pour les sœurs, la prière est parfois un combat dans la mesure où notre esprit, par nos vies et nos préoccupations, est tenté de se disperser. La prière est à la fois simple et compliquée, elle demande un effort, un choix, celui d’en faire une priorité dans sa vie. Pour le pasteur Benoît Ingelaere, prieur de Caulmont, la prière a vocation à transformer la manière de vivre dans le monde.
Moins seul pour prier
Le silence fait partie de la prière ; c’est peut-être même la partie la plus importante. En effet, se tenir en silence devant Dieu, c’est permettre à Dieu de donner la prière à celui qui veut prier. Le silence dans les activités quotidiennes ou pendant les repas permet d’éviter les paroles futiles et de rester dans la relation à Dieu, la méditation (Diaconesses, Pomeyrol, Veilleurs…).
Mais dans la vie quotidienne, le croyant en Christ peut se sentir un peu seul pour prier et éprouver le besoin d’un support, d’une structure aidante.
Certains choisissent d’entrer dans la Fraternité spirituelle des Veilleurs. C’est au terme d’une recherche spirituelle personnelle que l’on peut devenir Veilleur. Les Veilleurs ont une règle de vie qui aide à la vie chrétienne et dans la relation avec ses proches, dans l’esprit des Béatitudes : avec « joie, simplicité et miséricorde ». L’objectif est d’approfondir sa relation à Dieu pour arriver à une harmonie intérieure. L’ancrage dans une communauté locale chrétienne est demandé. Aujourd’hui, on compte quatre cent cinquante Veilleurs et quatre cents sympathisants, qui participent à des retraites aux Abeillères. Les Veilleurs sont une présence discrète et priante au milieu des communautés locales et du monde.
D’autres choisissent de participer aux offices des communautés, soit parce qu’ils habitent à proximité, soit parce qu’ils souhaitent vivre une retraite spirituelle.
Faire une retraite
Les retraites, différentes selon les lieux, sont très demandées et les communautés sont « spécialisées » dans l’accueil.
Chez les Diaconesses (Versailles, Mazet, Strasbourg), chez les sœurs de Pomeyrol et aux Abeillères, il y a des temps communautaires et des temps de prière personnels ; la place du silence est importante, ce qui peut dérouter des personnes très fragiles. Mais vivre au rythme liturgique de la communauté, prendre du temps à part dans sa vie, bénéficier d’un accompagnement individualisé est « ressourçant ».
D’autres lieux, que l’on pourrait qualifier de mixtes, accueillent des « retraitants », des familles chrétiennes, des touristes ou des gens de passage ; c’est le cas de Caulmont, sur son site des Sapins à Devesset (Ardèche). L’ensemble de la vie quotidienne est spirituel, avec des temps liturgiques. La dimension écologique est importante, le lieu parraine label Église verte. Un potager en permaculture et quelques animaux permettent de vivre sans épuiser la terre. Prier, c’est vivre en harmonie avec toute la création.
À Caulmont, on accueille les familles, mais à Taizé, les jeunes vont généralement sans leurs parents. Taizé a beaucoup de succès auprès des jeunes catholiques et protestants. Les séjours sont de plusieurs jours, rythmés par des célébrations (avec du silence) et des groupes de discussion.
La place des communautés est donc importante dans la communion des Églises. Ce sont des lieux d’accueil profondément spirituels et humains, proposant un mode de vie alternatif au monde d’aujourd’hui.














