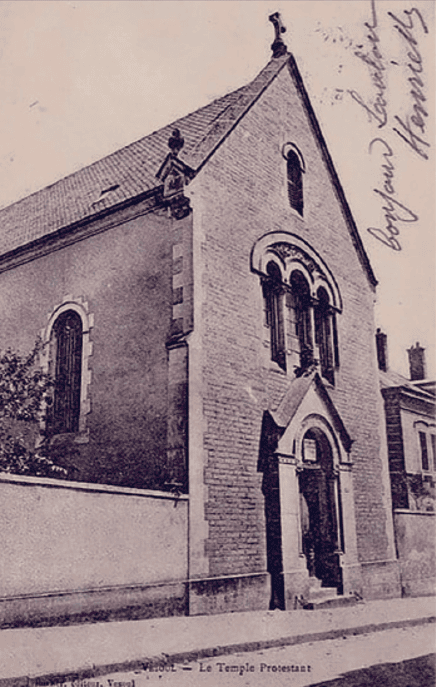Le terme «proche aidant» est apparu en 2005 dans le contexte de l’accompagnement par une personne vivant sous le même toit de personnes âgées en perte d’autonomie. Puis, en 2015, la loi élargit la compréhension à l’entourage des personnes en perte d’autonomie, incluant ainsi le conjoint, le partenaire pacsé, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle. Ces proches aidants apportent une aide régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Un service souvent involontaire
Dans les faits, il s’agit de prendre acte d’une évolution sociétale. La plupart des familles vivaient jadis sous le même toit, entre générations. Les anciens gardaient les plus jeunes et lorsqu’une maladie ou une infirmité frappait un proche, les solutions de soutien se trouvaient naturellement au sein de la cellule familiale.
Ce temps est révolu, chaque enfant qui s’établit en couple désirant un toit qui lui soit propre. Chaque génération adulte se retrouve donc seule et, en cas de besoin, l’aide à la personne est donc plus difficile à mettre en place. Il arrive bien souvent que l’un des plus proches, pour faire face à une situation devenue urgente, se rende libre pour se tenir à côté de la personne dépendante. Certains suspendent leur activité professionnelle pour des congés, d’autres viennent juste donner un coup de main et se retrouvent dans une situation imprévue à assumer sur le long terme. Car beaucoup le disent: leur fonction de proche aidant n’était pas souhaitée au départ, elle leur fut souvent imposée par une proximité affective ou une filiation de laquelle ils ne pouvaient se détacher.
Une charge mentale colossale
«C’est pour un temps, on va trouver une solution». La conscience d’une situation passagère explique qu’une grande partie des aidants ne se reconnaissent pas comme tels au regard de la loi. Pourtant, la charge à assumer est souvent colossale et demande une aide extérieure, voire une formation, que dispense parfois les services sociaux et sanitaires du département.
Bien sûr, l’État français propose des solutions, via des associations, des temps de répit en institution ou une forme d’indemnité qui se rapproche d’un salaire. Une réflexion du gouvernement a été relancée en octobre 2023 pour étoffer encore la loi et mieux reconnaître la fonction d’aide, en rapprochant son statut précaire de celui de métier temporaire. Mais pour le proche aidant, le souci est aussi personnel; la charge mentale et physique est lourde, elle implique les dimensions physique, psychique, sociale et spirituelle. L’aide apportée touche alors au sens de la vie et peut impliquer une souffrance importante due à l’engagement de nombreuses personnes au-delà de leurs forces.
L’implication spirituelle
Si la collectivité reconnaît donc et prend en compte l’engagement des proches, les sacrifices sont souvent importants: perte d’emploi, impossibilité d’une vie personnelle indépendante, isolement des réseaux d’amitié. Tout cela se met en place au cours d’une évolution lente, la meilleure illustration en étant le retour à la vie normale: le proche aidant peut alors ressentir un vide important exigeant un accompagnement.
Ce cadre pourrait paraître bien sombre, beaucoup de lacunes existant dans la reconnaissance et la prise en charge des aidants. Mais la plupart des aidants témoignent du sens de leur action avec un sourire qui illumine leurs cernes: «Je redonne une part de ce que j’ai reçu», «On ne peut pas laisser les gens comme ça», «On n’a jamais été aussi proches». Ces mots disent la force de l’engagement et du témoignage qu’il porte.
Certaines actions sont bien sûr à proscrire, par exemple lorsqu’il s’agit de voir un parent nu, diminué ou insultant. Toucher à l’intimité de ceux qui nous ont donné le jour n’est jamais neutre. Peut-être les paroisses sont-elles alors à même de faire une priorité de l’accompagnement de ces aidants, en permettant des temps de répit ou en accompagnant spirituellement les personnes engagées.