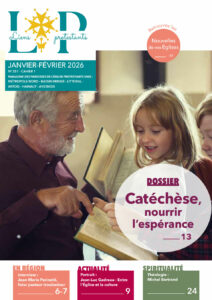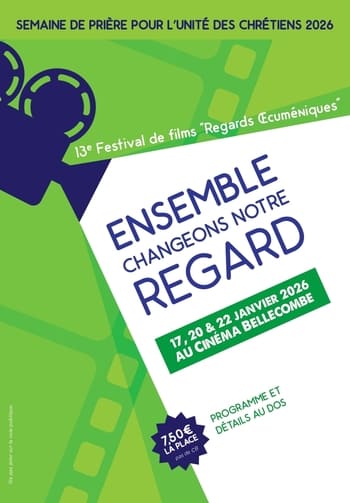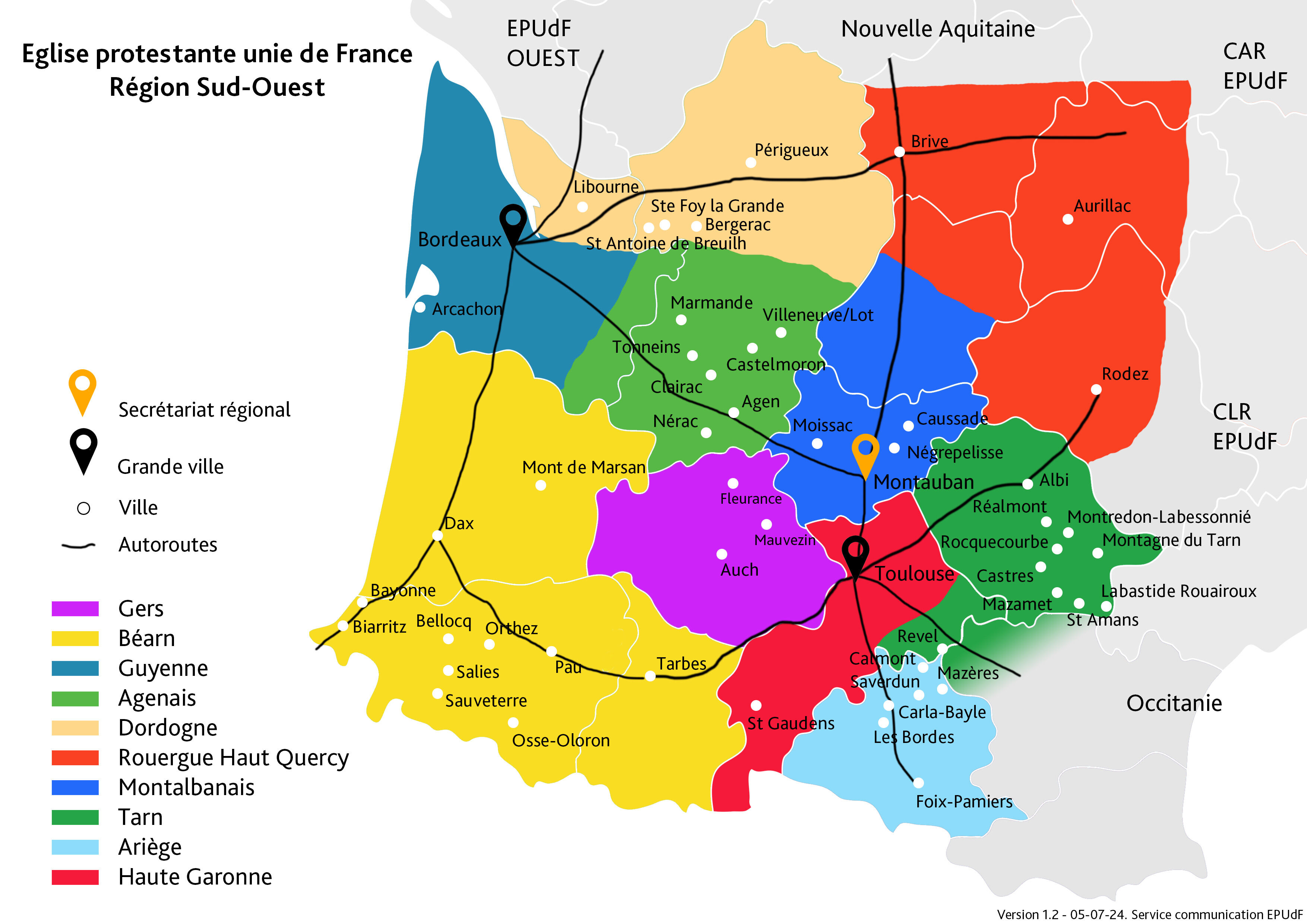© Éric Deheunynck
Les origines de la communauté
Maubeuge est une ancienne cité drapière du Hainaut. En 1566, le comté devient l’épicentre de la révolte des Pays-Bas. Valenciennes, sa capitale devenue calviniste, se révolte. La répression espagnole y est féroce et le réformateur Guy De Brès y est pendu en 1567. Mais à Maubeuge, aucune communauté réformée n’est alors attestée. Certes, des protestants sont bien présents dans la cité : les sources judiciaires nous donnent quelques noms.
En 1572, le seigneur François de Glarges participe à la prise de Mons par les huguenots et les gueux, unis pour l’occasion. Il est décapité après la reprise de la ville par les Espagnols. En 1573, Antoine Géhennart est supplicié pour avoir résisté aux troupes du duc d’Albe. Puis plus aucun protestant n’est mentionné, si ce n’est quelques fugitifs interceptés à la frontière toute proche.
Une véritable communauté n’apparaît qu’au moment du Réveil du XIXe siècle. Un petit noyau de protestants se forme progressivement grâce au passage de colporteurs bibliques, d’évangélistes et de pasteurs venus de Belgique, notamment de Dour. En 1845, une première salle est louée pour la communauté disséminée dans le Val de Sambre. En 1859, le culte réformé est officiellement autorisé dans la cité. Maubeuge devient, en 1861, une annexe de la paroisse du Cateau. Elle est desservie par le pasteur de cette ville, qui assure cultes et visites. La communauté naissante reste cependant privée d’un pasteur attitré et d’un lieu de culte digne de ce nom, c’est-à-dire d’un temple.
Le temps de l’apogée : une paroisse, un temple
Le premier temple, aujourd’hui appelé « l’ancien temple », est construit en 1876-1877 selon les plans de l’architecte suédois Hansen. Inauguré dès 1878, il a aujourd’hui disparu, mais des photographies permettent d’en
apprécier l’aspect.
La façade, richement décorée, présente un fronton surmonté d’une rosace, des contreforts coiffés de pinacles, et une porte encadrée de deux colonnes corinthiennes surmontée d’une Bible ouverte sculptée. Dix-sept arceaux décorent le pignon, tandis que de nombreuses inscriptions bibliques ornent la façade.
L’intérieur était lui aussi remarquable : l’abside en demi-cercle abritait une chaire avec escalier à double volée ; les boiseries conféraient une atmosphère chaleureuse (avant la rénovation de 1947). Comme pour le temple du Cateau, les moyens n’avaient pas manqué grâce au soutien d’industriels protestants de la région, tels que les
Seydoux.
Ce n’est qu’en 1889 que Maubeuge se détache du Cateau pour devenir une paroisse à part entière. Au début du XXe siècle, la communauté connaît son apogée et dispose même de deux pasteurs.
Le temple, fortement endommagé en septembre 1944, est rénové et rouvre en 1947. Toutefois, certains éléments de la structure demeurent fragilisés.

© Éric Deheunynck
Le temps de la raison : un nouveau temple
Le temple est finalement démoli en février 1987. Son état s’était progressivement dégradé en raison des inondations à répétition, d’un début d’incendie et d’actes de vandalisme. À une époque où n’existait aucune fondation pour le patrimoine, la question de la réhabilitation se posait simplement : qui allait payer les réparations ? Problème d’autant plus complexe que l’usager (l’Église réformée de France) n’était pas le propriétaire (la Société chrétienne du Nord).
Il est finalement décidé qu’en échange du terrain, la société CIL construirait une salle de culte et deux salles annexes dans un nouvel ensemble immobilier. Le premier culte y est célébré en 1989. De l’ancien temple, il reste le mobilier : la chaire, la table de communion, les panneaux de cantiques, les bancs, l’harmonium et une Bible, version Ostervald de 1841. Mais la communauté n’a plus de pasteur depuis 2016.
Le cas du temple de Maubeuge soulève une question de fond : faut-il préserver notre patrimoine ou se préoccuper d’abord des communautés ? En d’autres termes, faut-il donner la priorité aux vieilles pierres ou aux pierres vivantes ? Parfois, des choix douloureux s’imposent.

© Éric Deheunynck

© Éric Deheunynck
Prochainement : Quiévy, le plus grand temple du Nord.
Pour aller plus loin : PRUVOST Jean-Baptiste, Journal d’un pasteur protestant au XIXe siècle, Presses universitaires du Septentrion, 1996.