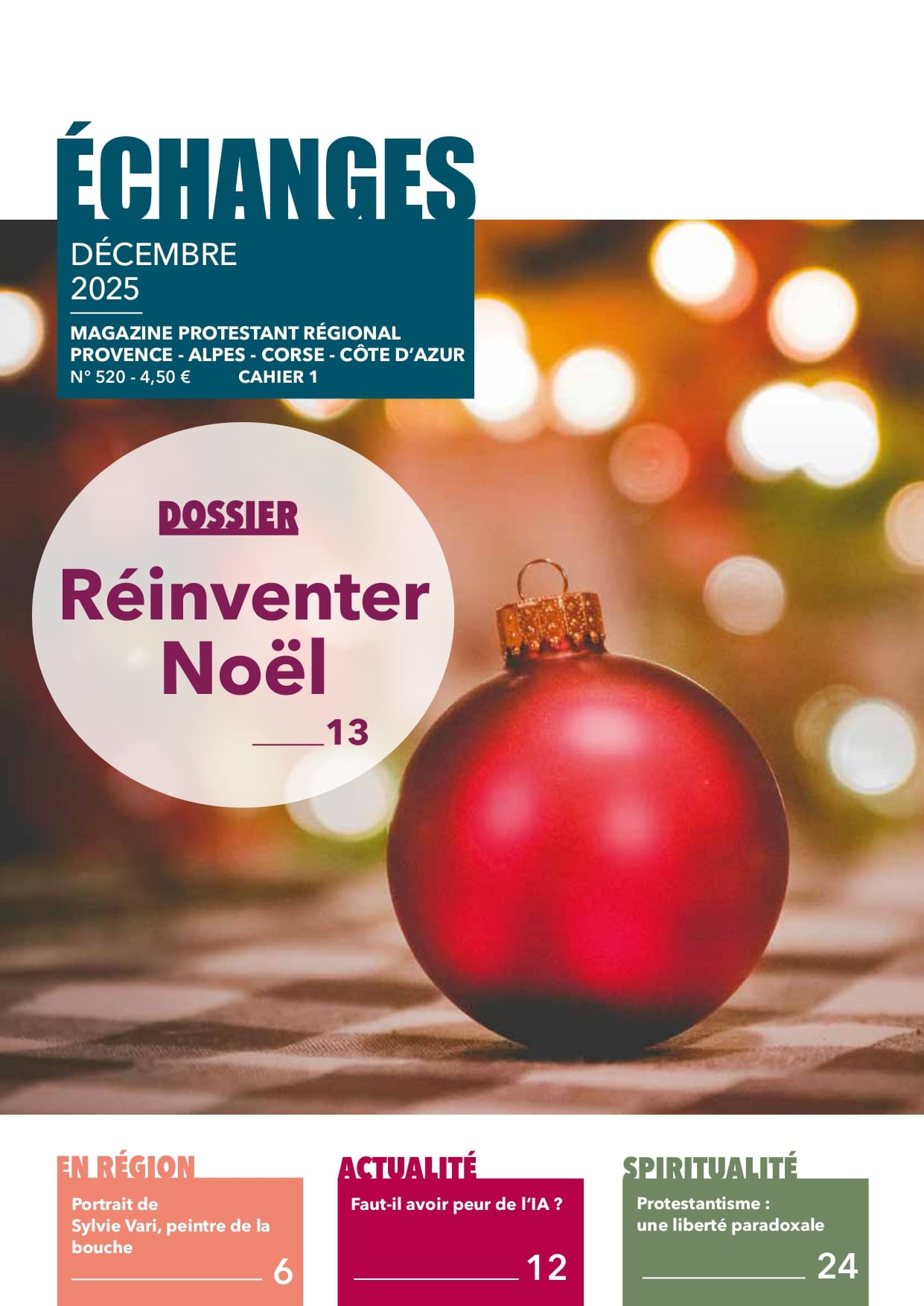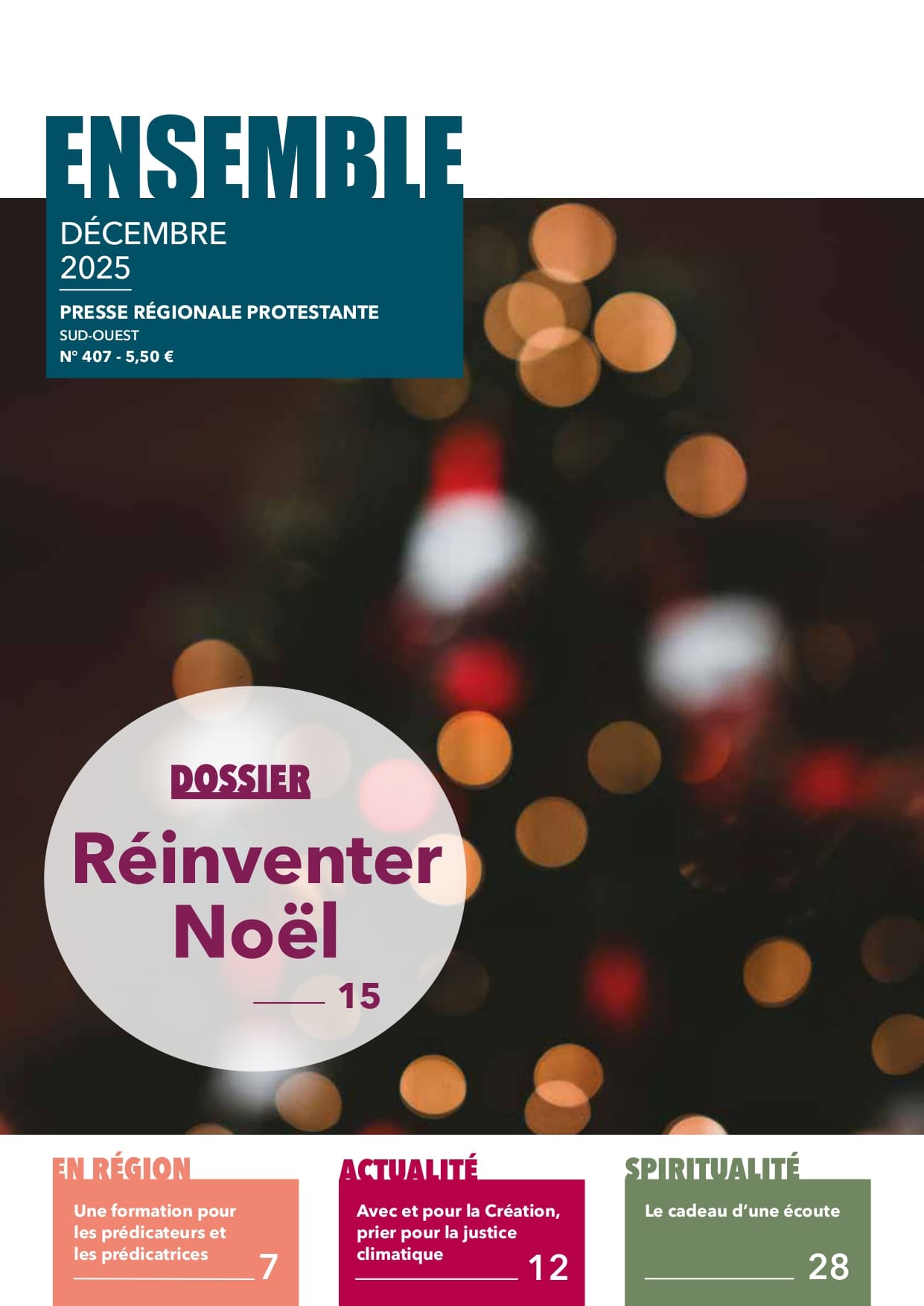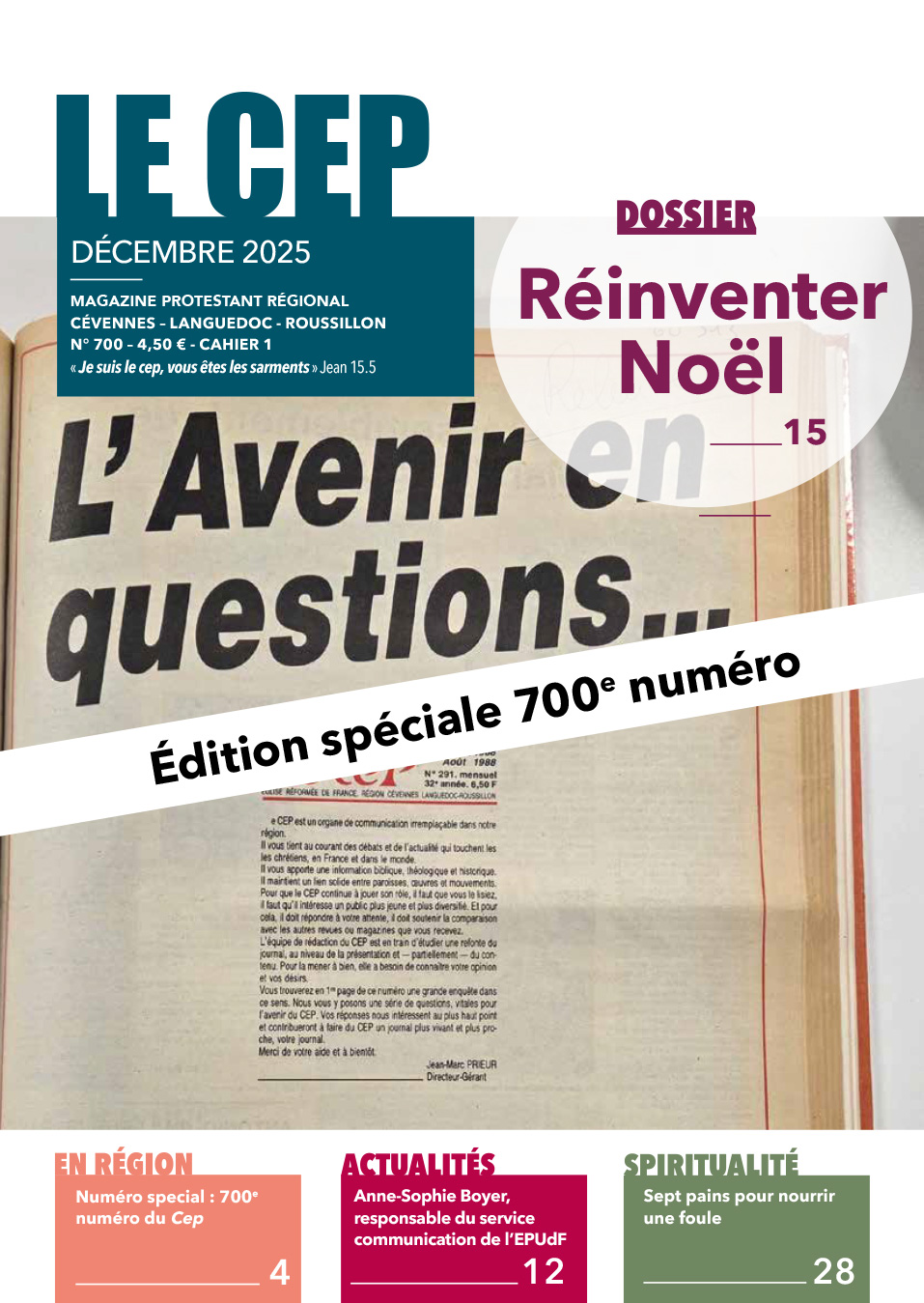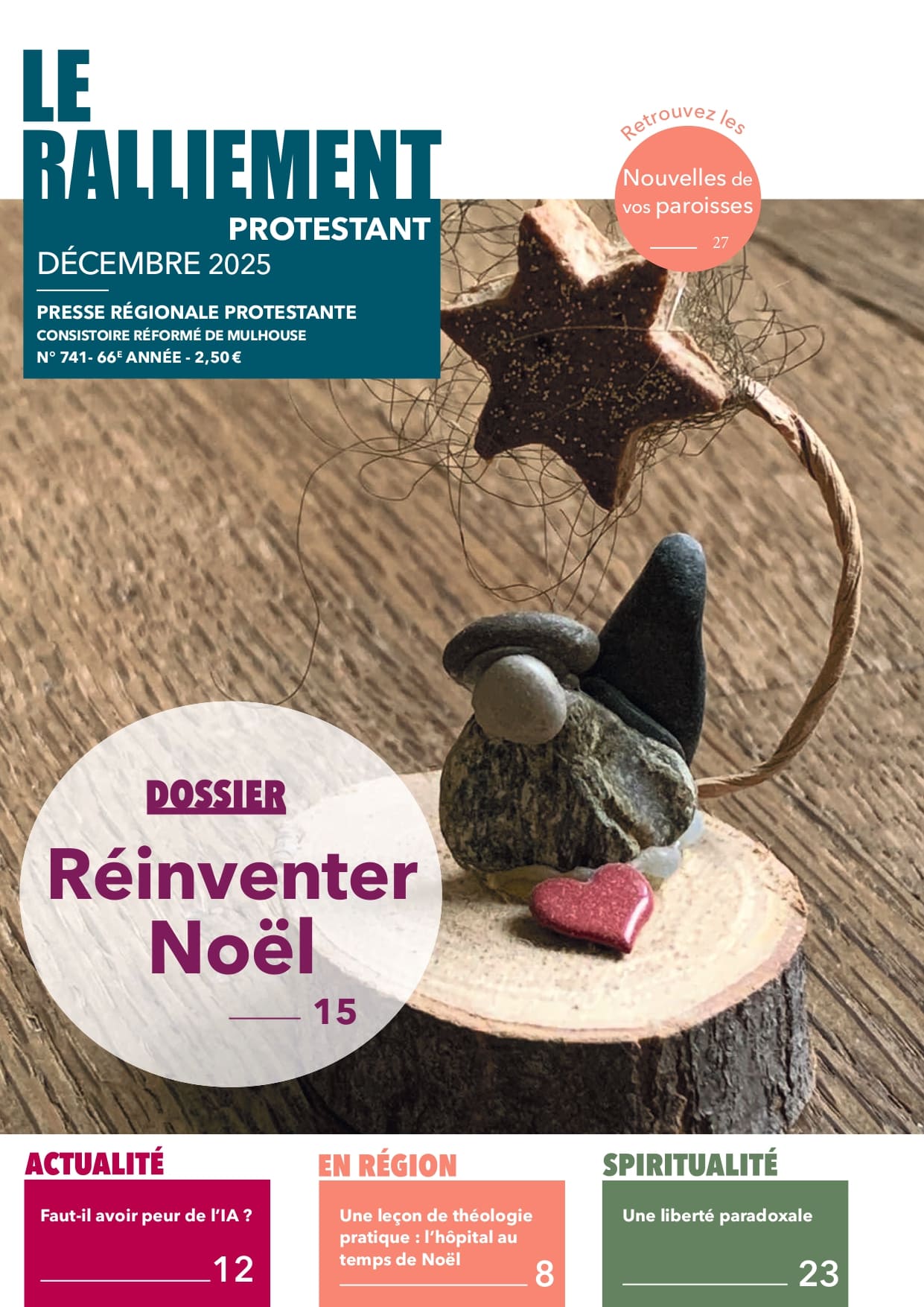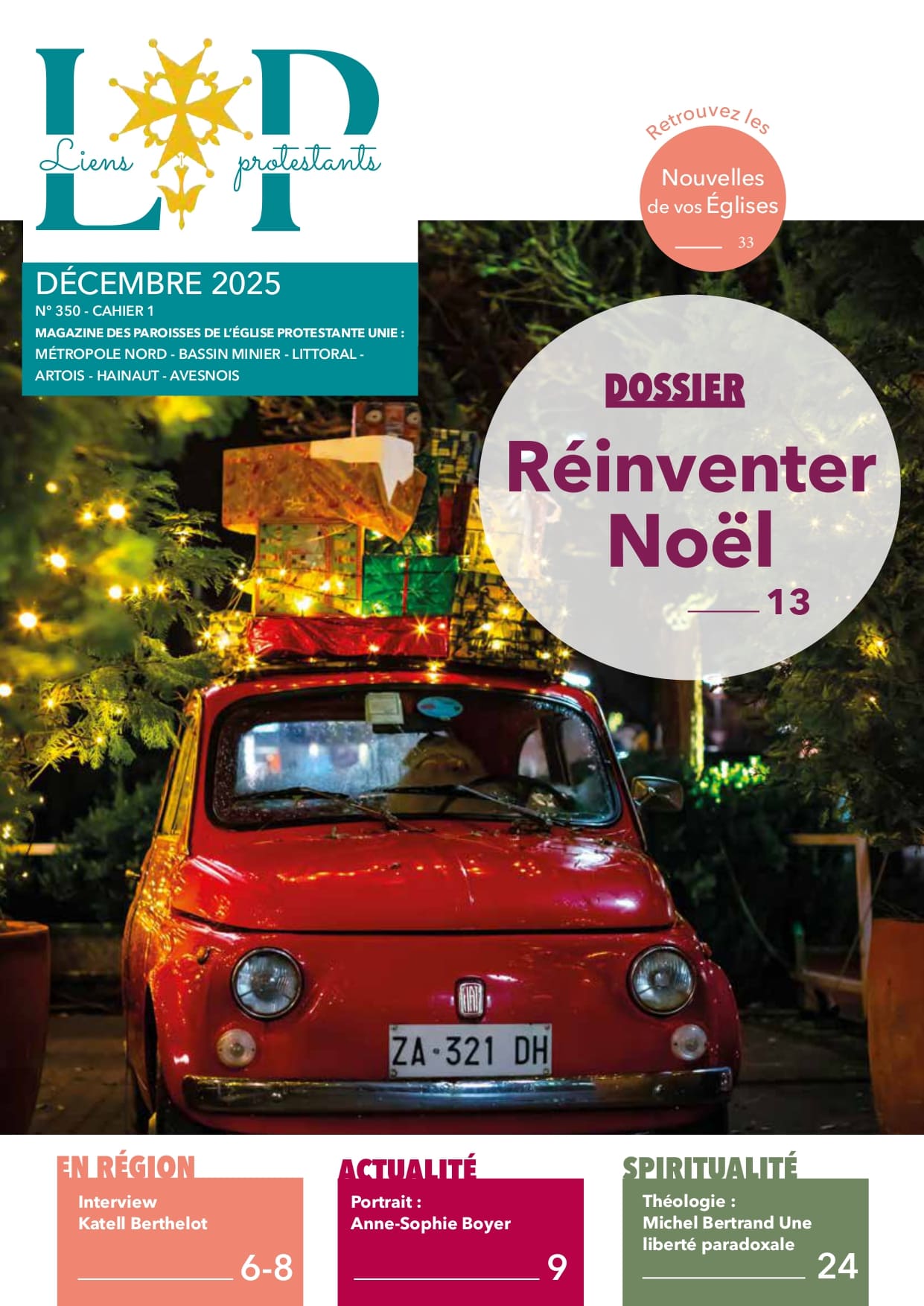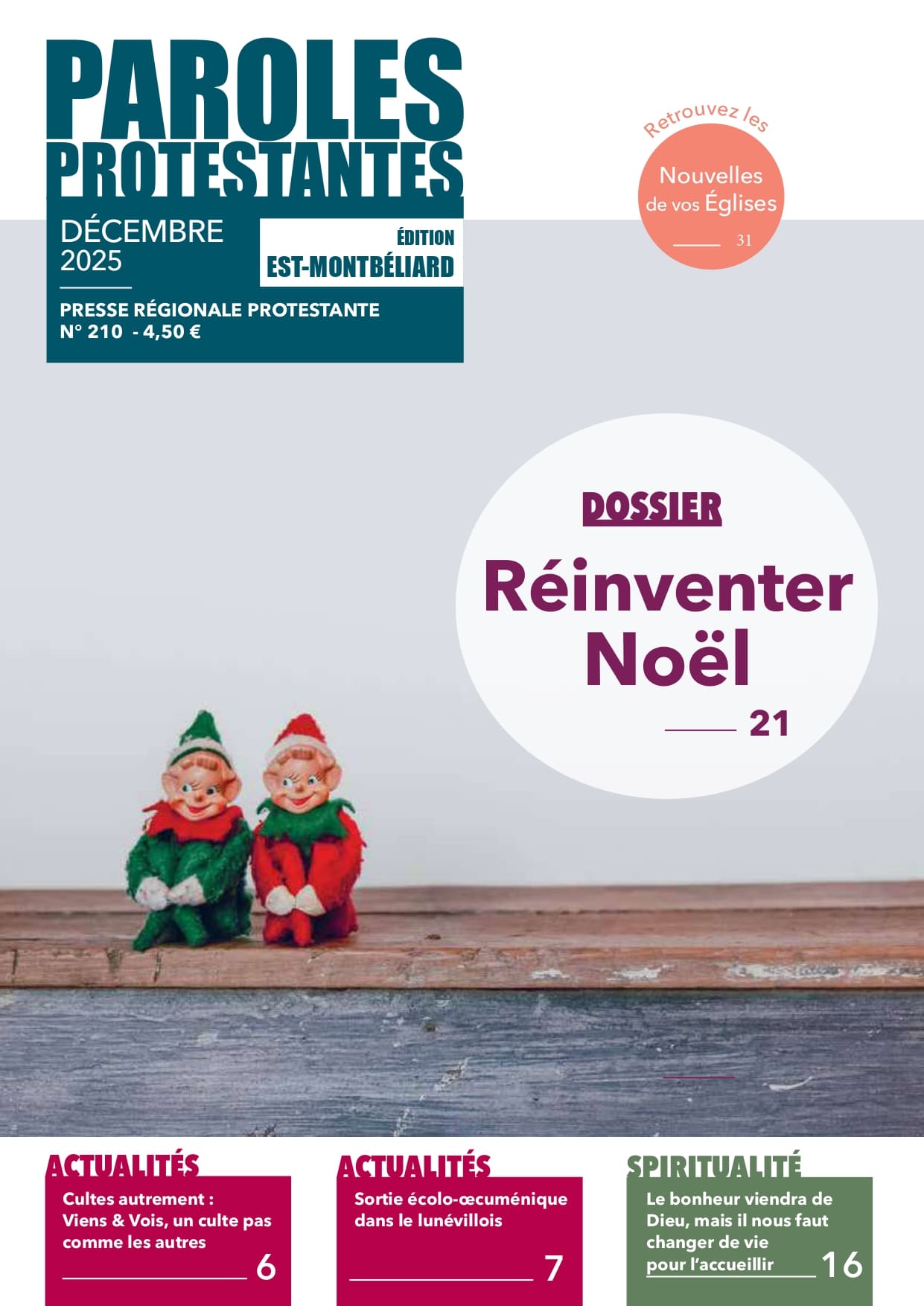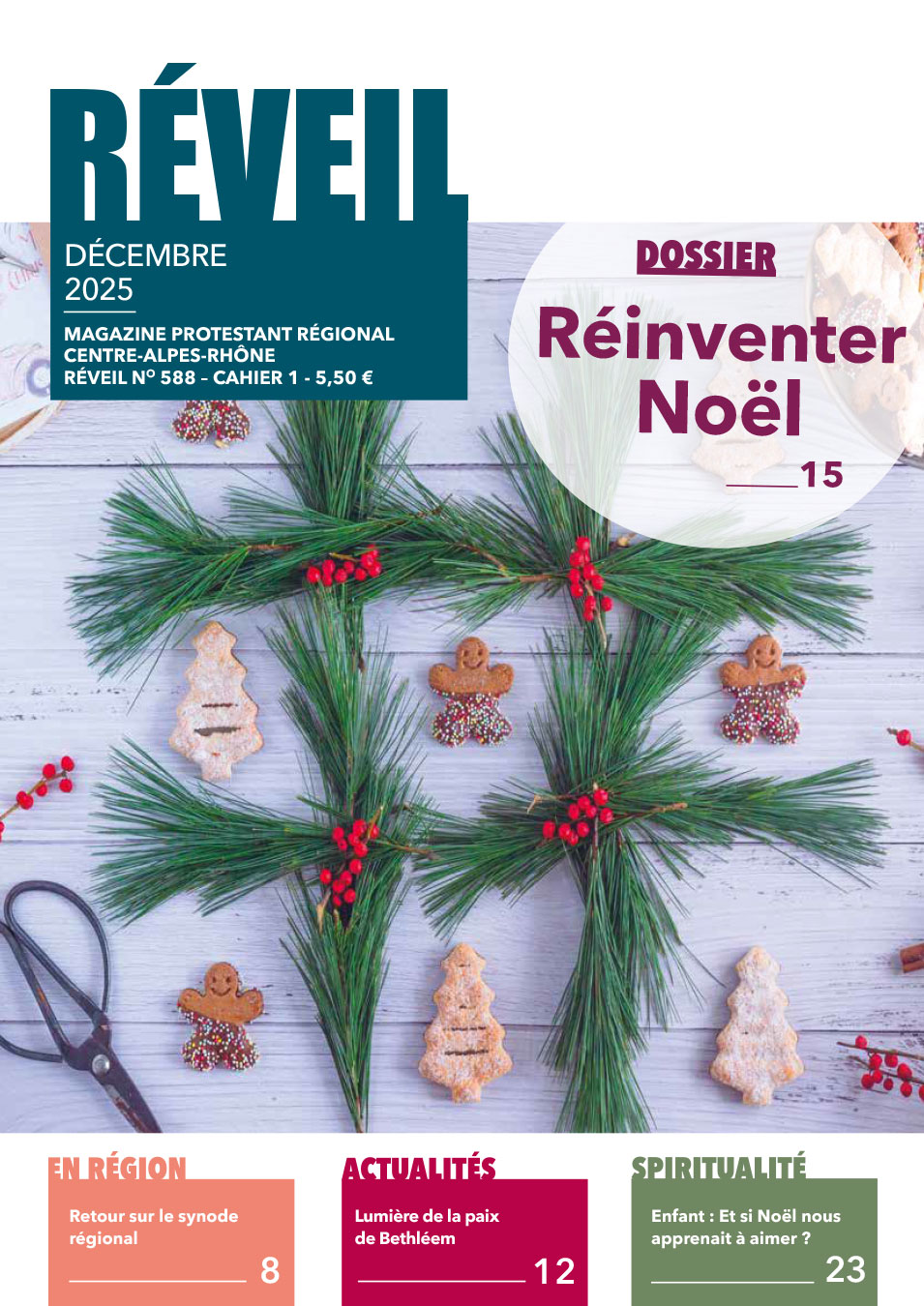Les premières réflexions françaises sur les responsabilités chrétiennes face à la Création, portées par une volonté d’institutions ecclésiales, émergent en contexte alsacien-mosellan : au cours des années 1970, les deux Églises luthérienne et réformée de cette région mettent en place une Commission de la défense de la nature. Celle-ci publie, dès 1979, un ouvrage collectif intitulé : Nature menacée et responsabilité chrétienne. Cette première initiative institutionnelle se trouve aussi en phase avec une grande sensibilité aux questions environnementales propre à la population alsacienne, et donc aux membres de ces Églises. Aussi n’est-il pas surprenant que le premier colloque œcuménique organisé en France sur le thème de la sauvegarde de la création se soit tenu au Liebfrauenberg, dans le Bas-Rhin, en 2005. L’Uepal sera la première Union d’Églises à créer, en 2019, un poste de chargé de mission pour la Justice climatique, ministère spécialisé au service des paroisses.
Pour ce qui concerne l’Église réformée de France, les premiers textes officiels apparaissent en 2008 et en 2013 dans sa revue intitulée Information – Évangélisation. Ils portent sur les thèmes suivants : « Les chrétiens, l’environnement et le développement durable », puis : « “Sur le rebord du monde”, quand écologie et théologie se rencontrent ». Ces deux numéros attestent d’une prise en compte progressive des questions environnementales et de l’émergence d’un intérêt pour l’action effective mise en place par les Églises locales. L’EPUdF choisit pour son Synode national de 2021 le sujet suivant : « Écologie : quelle(s) conversion(s) ? » Mise au cœur des réflexions, des débats et des engagements de l’Église, la thématique de l’écologie se voit désormais consacrée comme un chemin décisif de la mise en œuvre de la foi protestante.
Des actes pour poser un cadre
Ce Synode a produit et voté trois textes de référence : un document théologique, qui rend compte successivement de « la promesse de la Création », du « cri de la Création », et du « service de la Création » ; un document éthique, qui invite à une « puissance retenue » et qui trace des alternatives aux tentations d’une sortie autoritaire ou technicienne de la crise ; enfin, un texte de recommandations pratiques. Parmi les gestes forts impulsés par ce dernier, il faut relever la création d’un poste rémunéré pour assurer l’animation, la communication et la cohérence des engagements de l’Église ; la sollicitation du réseau jeunesse et des commissions catéchétiques à élaborer des propositions pédagogiques centrées sur notre rapport à la Création ; l’engagement à limiter les placements financiers de l’Église à des secteurs non carbonés ; l’accompagnement des peurs nouvelles qui naissent de la crise écologique et le témoignage de la confiance en Dieu et de la joie que procure la simplification de vie.
Au niveau de la Fédération protestante de France, un texte de réflexion est publié en 2003 sous l’intitulé : « Environnement et développement durable », suivi de plusieurs « Contributions au débat » en 2006. En 2014, la FPF suscite un groupe de travail sur le dérèglement climatique, chargé de rédiger un texte pour servir de base à la réflexion en vue de la COP 21 de décembre 2015 ; ce texte est publié en 2014 sous le titre : Les changements climatiques. La même année 2014, un colloque est organisé conjointement par la commission « Église et Société » de la FPF, le réseau « Bible et Création » et l’EPUdF. Il porte le titre suivant : « Terre créée, terre abîmée, terre promise ». En 2017 est créée une commission « Écologie et Justice climatique » de la Fédération protestante de France.
Si l’on porte à présent notre attention sur les Églises locales, les initiatives et les engagements frappent par leur multiplicité et par leur diversité. L’innovation la plus récurrente se situe au niveau liturgique. L’élan en est donné en 2006, lorsque le Conseil œcuménique des Églises suggère de faire d’un dimanche annuel un « Temps pour la Création ». Du matériel liturgique est diffusé : textes, choix de cantiques… C’est une occasion pour le prédicateur de revisiter les textes bibliques de Création et d’en dégager une interprétation actualisante.
Poursuivre les efforts malgré les freins
Distinctes ou articulées à la célébration du « Temps pour la Création », nombre d’Églises locales ont mis en place des fêtes de paroisse centrées sur la thématique de l’engagement en faveur de la sauvegarde de l’environnement : conférence-débat, repas éco-responsable, spectacle, marche de découverte dans la nature, stands et jeux, méditation et chants… La difficulté, dans certaines Églises locales, à faire admettre l’usage de vaisselle recyclable ou à réduire le recours au suremballage ou la consommation de viande lors des repas de paroisse, souligne bien où se situent les défis liés à l’articulation entre convictions et pratiques concrètes. Les repas et les fêtes, dont on connaît l’acuité de la symbolique, permettent en effet d’éprouver la capacité de cohérence entre la foi et la vie. Même l’organisation du covoiturage pour se rendre au culte ou à toute activité de paroisse rencontre quelques freins lorsqu’elle remet en question des habitudes d’autonomie individuelle – elle reste néanmoins l’innovation la plus facile à mettre en œuvre, et la plus appréciée, quand elle n’est pas déjà une habitude pour certains.
Le recours aux énergies renouvelables pour le temple et le presbytère revient souvent parmi les propositions qui auraient assurément du sens : il s’agirait d’un engagement réel, d’un investissement conséquent, en faveur de la réduction de la consommation d’énergies fossiles, et donc au final en faveur du climat et de la qualité de vie des générations futures. Les freins ne se situent cependant pas tant sur le plan financier que du côté de l’intégrité du patrimoine immobilier de l’Église, mise en avant pour s’opposer à cette innovation.
La création d’un label « Église verte », en 2016, a pu encourager nombre d’engagements concrets de paroisses en faveur du respect du vivant. Cette labellisation peut signifier toutes sortes d’engagements au service de la Création. Ce sont déjà plus de 800 communautés, dont une centaine de l’EPUdF, qui bénéficient de ce label.
Ainsi, malgré les multiples freins, l’engagement des Églises en écologie apparaît aujourd’hui comme une tendance forte du protestantisme. Par-delà sa diversité, il se structure autour d’un axe cohérent : l’articulation de la foi protestante et des œuvres au service de la sauvegarde de la Création.