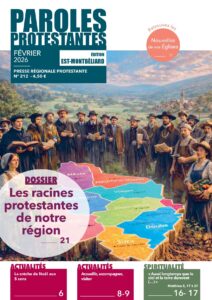Les explorations du XVIe ont donné un élan à la dynamique missionnaire, qui a longtemps suivi, comme l’anthropologie, deux voies opposées : d’un côté l’ethnocentrisme intrusif, et de l’autre la collaboration respectueuse. De cette dernière sont issues des œuvres tel le Défap, mission de témoignage et de solidarité – une « caisse de résonance des espérances » selon la belle expression de son président Joël Dautheville.
Cette ambivalence apparaît déjà dans la célèbre controverse de Valladolid. En 1550-51, Charles Quint, sincèrement chrétien, mais soucieux aussi de la gestion de son empire, engage un débat : comment soumettre et convertir légitimement les Indiens ? Le théologien Sepúlveda soutient la thèse de l’infériorité des indigènes : l’esclavage et la conversion forcée sont donc légitimes ; tandis que le moine Las Casas défend leur nature humaine, et la nécessité de les respecter. Ce dilemme se résoudra d’une manière peu glorieuse : ce sont les peuples d’Afrique qui fourniront la main d’œuvre bon marché.
Et l’ambivalence va perdurer au fil des siècles : soit une relation compréhensive avec les autochtones, soit une domination en imposant le christianisme. En 1685, Colbert fait ce deuxième choix : le Code Noir définit les esclaves comme propriété de leurs maîtres. Ils doivent être baptisés et instruits dans la foi chrétienne, justifiant ainsi l’esclavage.
Inversement, si vous visitez la Maison de la Négritude à Champagney (Haute-Saône), vous pourrez découvrir un texte visionnaire dans les cahiers de doléances de 1789 : « Les habitants de Champagney ne peuvent penser aux maux que souffrent les Nègres dans les colonies, sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur, en se représentant leurs Semblables, unis encore à eux par le double lien de la Religion, être traités plus durement que ne le sont les bêtes de somme ».
Mais malgré l’abolition définitive obtenue en 1848 grâce à Schoelcher et Lamartine, l’Exposition universelle de 1889 relancera le débat : au « Village nègre », les peuples colonisés sont présentés comme primitifs, ayant besoin de la tutelle de l’état… Des anthropologues et ethnologues de l’époque l’utilisèrent pour étudier les prétendues différences entre « races ».
Et maintenant ? Récemment une ethnie inconnue a été repérée en Amazonie : il a été décidé de la protéger par un « cordon sanitaire » contre toute intrusion et contamination. Est-ce la bonne solution ?
Sommaire de Paroles protestantes Est-Montbéliard nº204