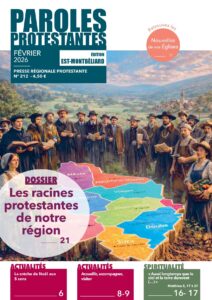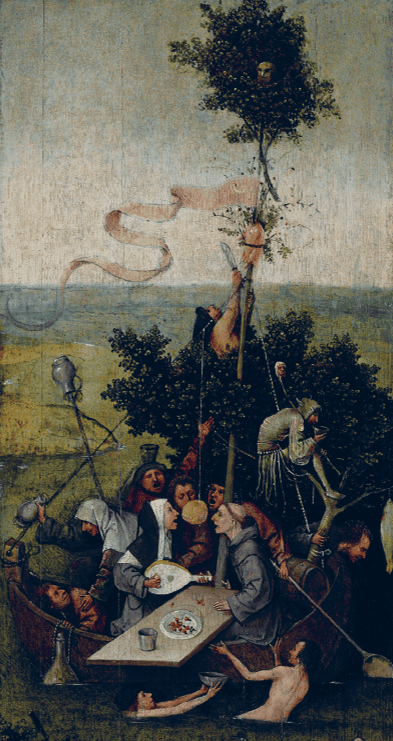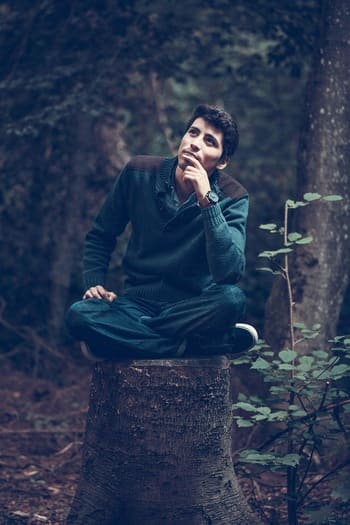Comme la spiritualité, la religion repose sur des croyances mais celles-ci sont organisées en un système. Deux schémas paraissent donc s’opposer : un plus réglementé avec des pratiques et des dogmes partagés entre croyants d’une même communauté et un plus libre et solitaire. Si on confronte par exemple bouddhistes et tarologues : les deux sont considérés comme des croyants, néanmoins les premiers sont intégrés dans notre société tandis que les seconds sont décrédibilisés.
Les spiritualités mystiques ont très longtemps été redoutées et perçues comme occultes. Nous sommes aujourd’hui sujets à un renouveau car le terme prend un sens plus léger. Je suis d’ailleurs étonnée de l’engouement qu’il suscite. Mais il est indéniable que le choix de parler de spiritualité plutôt que de religion permet de se défaire d’un passé houleux marqué par les guerres de religion.
Désacraliser les moments religieux permet aussi de démystifier nos pratiques. Par exemple les EEUdF (Éclaireurs, éclaireuses unionistes de France) différencient deux moments religieux lors de leurs camps : le « molou » (moment de louange) et le « mospi » (moment spirituel) afin d’ouvrir un espace de réflexion philosophique aux jeunes en parallèle d’un moment biblique.
Il apparaît donc très clairement que nous avons tous une définition différente de la spiritualité et que la confusion amène à un mélange de sens et d’emploi. Est-ce que croire aux Martiens, être végan ou parler aux morts incarnent aussi des spiritualités ?
Dans ce cas, si toute croyance est spiritualité, la religion aurait essentiellement pour mérite de rassembler une communauté autour de valeurs similaires.
Et vous, parlez-vous de religion protestante ou de spiritualité protestante ? Ou des deux ?